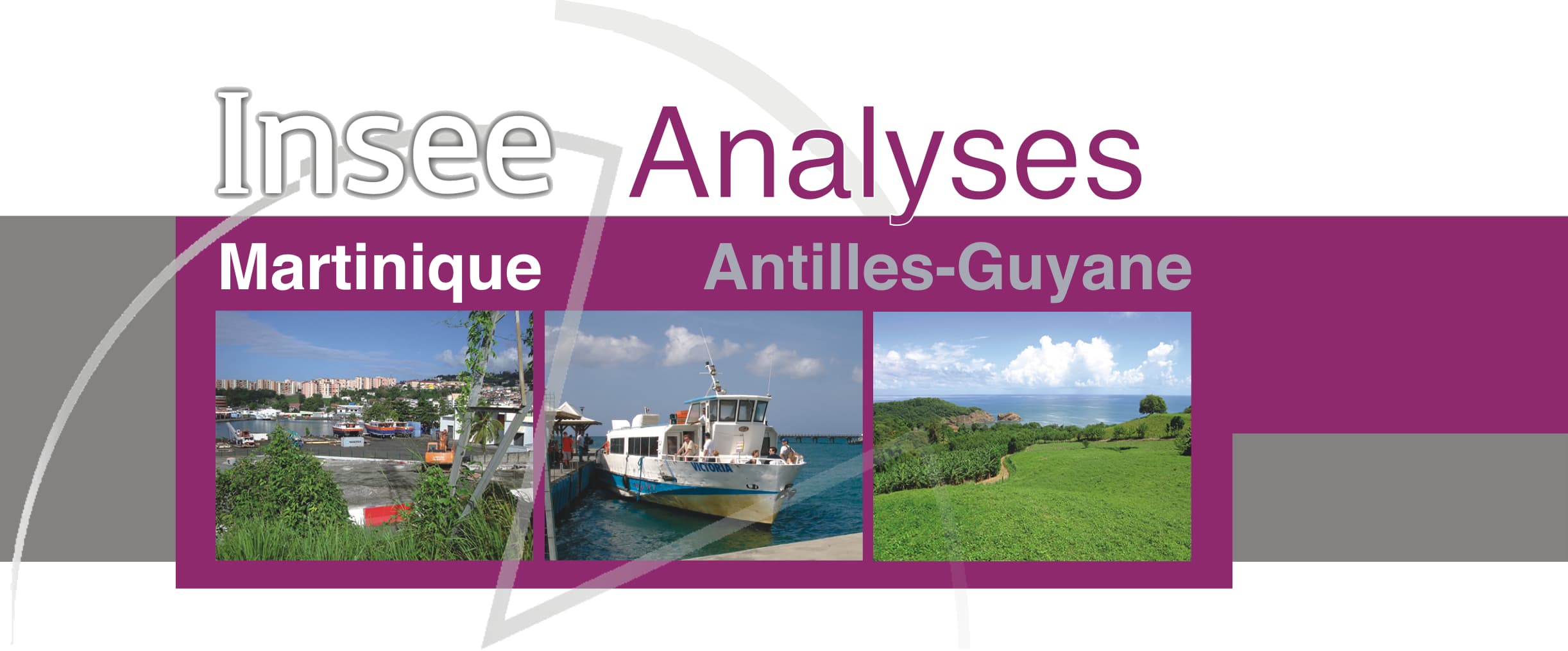 En 2014, l’activité s’améliore dans le BTP et l’industrie
En 2014, l’activité s’améliore dans le BTP et l’industrie
Après une année 2013 en repli, l’économie martiniquaise semble montrer quelques signes d’amélioration. Dans ce contexte, les entreprises principalement marchandes, ont créé près de trois milliards d’euros de valeur ajoutée en 2014.
La richesse créée par le secteur industriel progresse de 3 % en raison d’une hausse de l’activité des industries manufacturières et des industries extractives. L’activité dans la construction s’améliore grâce à deux importants chantiers en cours, le plateau technique de l’hôpital Zobda-Quitman et le Transport Collectif en Site Propre (TCSP).
La valeur ajoutée augmente pour plus de la moitié des entreprises actives entre 2013 et 2014. La création de richesses est plus concentrée en Martinique que dans les autres départements et régions d’outre-mer et 1 % des entreprises concentrent 46 % de la valeur ajoutée.
La moitié des petites entreprises sans salarié n’investit pas. Pour les entreprises employant 250 salariés ou plus, l’investissement est supérieur à 115 000 euros pour la moitié d’entre elles.
- Le secteur industriel progresse
- L’activité dans la construction s’améliore, mais souffre du lancement de nouveaux grands chantiers
- Un taux de marge élevé, davantage lié au besoin de financer des investissements
- Une valeur ajoutée médiane de 12 000 € pour les entreprises sans salarié
- 1 % des entreprises concentrent 46 % de la valeur ajoutée
- La valeur ajoutée augmente pour plus de la moitié des entreprises entre 2013 et 2014
- Investissement médian nul pour les entreprises sans salarié
Après une année 2013 en repli, l’économie martiniquaise renoue avec la croissance (+ 1,4 % en volume) en 2014. L’économie montre ainsi quelques signes positifs, à commencer par la consommation des ménages qui affiche une légère augmentation de 0,6 % en volume malgré une population qui baisse de 0,5 %. Cette progression est confirmée par une augmentation des importations de biens de consommation à destination des ménages, notamment de produits non alimentaires. L’industrie profite de cette embellie grâce à la progression des importations de biens manufacturés (+ 3,4 %), en lien avec la consommation des ménages qui reprend timidement.
Les entreprises, pour leur part, continuent d’investir tandis que l’investissement public se rapproche de sa moyenne de longue durée. Au global, l’investissement est le moteur de l’économie en 2014 et progresse de 4,5 % en volume. Les investissements des entreprises ont augmenté significativement en 2014 ; ils concernent autant le renouvellement de l’outil de production que de nouveaux projets. Les dépenses publiques soutiennent la croissance avec une hausse de leur consommation de 1,6 % en volume, notamment dans les domaines de la santé et des transports. Le secteur du Bâtiment et Travaux Public en est le premier bénéficiaire avec les travaux de construction du Transport Collectif en Site Propre et la reconstruction du plateau technique de l’hôpital Zobda-Quitman. Les ventes de ciment sont en progression sensible (+ 6,5 % à 182 265 tonnes), après plusieurs années consécutives de baisse.
Les entreprises, principalement marchandes, installées en Martinique, ont généré près de 3 milliards d’euros de richesses en 2014. À la même période, la valeur ajoutée dégagée par les entreprises guadeloupéennes s’élève à 2,8 milliards d’euros et celle créée par les entreprises guyanaises à 1,2 milliard d’euros.
Le secteur industriel progresse
En 2014, les richesses produites par le secteur industriel martiniquais s’élèvent à près de 475 millions d’euros, soit une progression de 2,8 % par rapport à 2013. Ce résultat est principalement lié au secteur des biens manufacturés pour lesquels les importations augmentent de 3,4 % en volume et la valeur ajoutée de 6 %, en lien avec une consommation des ménages qui reprend timidement. Dans une moindre mesure, les industries extractives participent à ce résultat.
Dans le secteur agroalimentaire, les exportations sont en légère hausse (+ 1,4 %) et la richesse dégagée par les entreprises progresse de 3 %. Toutefois, la situation reste mitigée : si la production de sucre augmente (+ 10,9 %), elle reste à un niveau bas. Pour sa part, la production de rhum diminue (– 3,5 %), suite d’un volume de canne broyée en baisse (– 6,2 %), les professionnels du secteur déplorant une insuffisance des volumes de canne pour satisfaire la demande locale des distilleries.
En 2013, la production de produits pétroliers raffinés avait sensiblement baissé en raison de l’arrêt programmé de la Société Anonyme de Raffinage des Antilles (Sara) pour contrôle et remise à neuf. En 2014, la production redémarre et retrouve quasiment le niveau de 2012. La Sara est composée d’une raffinerie en Martinique et de deux dépôts de carburant en Guyane et en Guadeloupe. Tous les six ans, la raffinerie du Lamentin interrompt son activité durant six semaines pour contrôle et remise à neuf : arrêt technique dit de « régénération ».
tableauFigure 1 – L’industrie et la construction génèrent plus d’un quart des richessesPrincipaux résultats des entreprises martiniquaises en 2014 (en millier d’euros)
| Secteur d'activité | Nombre d'unités | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée | Structure de la VA (%) | Excédent brut d'exploitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 473 | 2 332 572 | 475 145 | 16 | 153 854 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 534 | 336 447 | 98 991 | 3 | 24 587 |
| Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 229 | 142 794 | 36 554 | 1 | 3 962 |
| Construction | 4 369 | 1 087 341 | 316 904 | 11 | 57 448 |
| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 10 217 | 6 640 022 | 1 079 231 | 36 | 215 376 |
| Commerce : | 6 453 | 5 623 560 | 732 176 | 25 | 168 679 |
| dont : | |||||
| Commerce de gros, hors automobiles et motocycles | 1 382 | 2 005 575 | 171 356 | 6 | 29 390 |
| Commerce de détail, hors automobiles et motocycles | 4 115 | 2 859 376 | 430 476 | 14 | 110 647 |
| Transports et entreposage | 1 808 | 627 575 | 195 710 | 7 | 32 171 |
| Hébergement et restauration | 1 956 | 388 888 | 151 345 | 5 | 14 526 |
| Information et communication | 821 | 442 281 | 183 006 | 6 | 99 437 |
| Activités immobilières | 1 590 | 359 321 | 207 928 | 7 | 140 099 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 14 738 | 1 191 626 | 661 290 | 22 | 223 592 |
| Activités de services administratifs et de soutien | 12 051 | 764 924 | 430 971 | 14 | 162 746 |
| Autres activités de services | 2 217 | 300 518 | 62 862 | 2 | 14 218 |
| Ensemble | 36 425 | 12 353 681 | 2 986 366 | 100 | 904 023 |
- Source : Insee – Esane 2014 (données individuelles).
L’activité dans la construction s’améliore, mais souffre du lancement de nouveaux grands chantiers
Malgré la dégradation de la fin de l’année, l’activité s’améliore en 2014 dans le BTP et dans les industries liées au secteur. Le secteur du BTP représente 10,6 % de la valeur ajoutée totale produite par les entreprises, principalement marchandes, soit un point de plus que l’année précédente.
Cette embellie se traduit par une progression des ventes en vrac (+ 10,9 % par rapport à 2013). Généralement destinées aux chantiers d’envergure, elles sont principalement alimentées par le chantier du plateau technique de l’hôpital Zobda-Quitman et celui du Transport Collectif en Site Propre. Par ailleurs, en 2014, 1 728 logements sociaux ont été financés pour une dotation globale de 42 millions d’euros (+ 3,7 % sur un an).
Pour autant, la situation reste incertaine et l’absence de perspectives quant à la programmation de nouveaux projets d’envergure laisse craindre de nouvelles difficultés.
Un taux de marge élevé, davantage lié au besoin de financer des investissements
En 2014, le taux de marge est de 30 % dans les secteurs principalement marchands, hors agriculture et secteurs financiers (figure 2). Selon les secteurs, il varie entre 18 % et 34 %, sauf dans l’information et la communication et les activités immobilières où il est notablement plus élevé (respectivement 54,3 % et 67,4 %).
Un taux de marge élevé résulte en général de la mise en œuvre d’un capital d’exploitation important ; il n’implique pas nécessairement une rentabilité économique forte (l’Excédent Brut d’Exploitation devant alors être rapporté à ce capital d’exploitation), mais sert à financer les investissements. Ainsi, l’industrie, avec un taux de marge de 32 % et un taux d’investissement de 11 % a une rentabilité économique de 6 %. A contrario, la construction, avec un taux de marge et un taux d’investissement relativement faible (respectivement 18 % et 7 %), a une rentabilité économique plus élevée (13 %).
tableauFigure 2 – Un taux de marge supérieur à la moyenne régionale dans les services aux entreprises et l’industrieQuelques ratios d’analyse financière des entreprises martiniquaises par secteur d’activité en 2014 (en %)
| Secteur d'activité | Taux de VA Vaht/CA | Taux de marge EBE/VA | part des frais de personnel FP/VA |
|---|---|---|---|
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 20,4 | 32,4 | 67,6 |
| Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 29,4 | 24,8 | 75,2 |
| Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 25,6 | 10,8 | 89,2 |
| Construction | 29,1 | 18,1 | 81,9 |
| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 16,3 | 20 | 80 |
| Commerce : | 13 | 23 | 77 |
| dont : | |||
| Commerce de gros, hors automobiles et motocycles | 8,5 | 17,2 | 82,8 |
| Commerce de détail, hors automobiles et motocycles | 15,1 | 25,7 | 74,3 |
| Transports et entreposage | 31,2 | 16,4 | 83,6 |
| Hébergement et restauration | 38,9 | 9,6 | 90,4 |
| Information et communication | 41,4 | 54,3 | 45,7 |
| Activités immobilières | 57,9 | 67,4 | 32,6 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 55,5 | 33,8 | 66,2 |
| Activités de services administratifs et de soutien | 56,3 | 37,8 | 62,2 |
| Autres activités de services | 20,9 | 22,6 | 77,4 |
| Ensemble | 24,2 | 30,3 | 69,7 |
- Source : Insee – Esane 2014 (données individuelles).
Dans l‘hôtellerie et la restauration, le taux de marge se détériore, la progression de la masse salariale ayant été deux fois plus élevée que celle de la valeur ajoutée.
Dans l’information et la communication, le taux de marge recule sous l’effet de l’augmentation des frais de personnel, l’impact du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) étant faible dans ces secteurs où les salaires sont élevés.
Dans les activités immobilières, le taux de marge des entreprises est plus de deux fois supérieur au taux de marge global. Il s’explique par la présence de nombreuses sociétés civiles immobilières (SCI) sans salarié. En effet, le taux de marge des unités légales sans salarié atteint fréquemment 100 %. L’entrepreneur individuel, bien qu’il puisse comptabiliser une partie de ses revenus ou charges patronales obligatoires en charges de personnel, se rémunère le plus souvent sur le résultat de son entreprise sans retenir de charges de personnel.
Une valeur ajoutée médiane de 12 000 € pour les entreprises sans salarié
En 2014, la moitié des entreprises de 250 salariés ou plus dégagent une valeur ajoutée supérieure à 637 000 euros (figure 3). Cette valeur médiane est 1,2 fois supérieure à celle des entreprises de 10 à 249 salariés, dix fois supérieure à celle des 1 à 9 salariés et 53 fois supérieure à celles n’ayant pas de salarié. Cependant, en termes de disparités, les écarts de valeur ajoutée, mesurés par le rapport interquartile (3ᵉ quartile/1ᵉʳ quartile) sont beaucoup plus faibles parmi les entreprises employeuses et celles sans salarié : ils se situent à 8 pour les entreprises employeuses et à 12 pour les entreprises sans salarié. Pour ces dernières, la dispersion plus élevée s’explique par une forte hétérogénéité : on y retrouve des artisans, des professions libérales, mais aussi des holdings, des SCI, etc. Un quart de ces entreprises sans salarié ne dégagent quasiment pas de valeur ajoutée. Avec une valeur ajoutée médiane de 12 000 euros, ce sont ainsi près de 20 000 unités qui ne financent pas l’équivalent d’un Smic, dont le coût annuel à temps plein, charges patronales comprises est de près de 20 000 euros.
tableauFigure 3 – Forte concentration de l’investissement et de la valeur ajoutéeConcentration de la valeur ajoutée et de l’investissement des entreprises martiniquaises en 2014
| Part cumulées des entreprises (%) | Part cumulées de la valeur ajoutée (%) | Part cumulées de l'investissement (%) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 46,36 | 60,71 |
| 2 | 55,74 | 74,74 |
| 3 | 61,72 | 85,08 |
| 4 | 66,06 | 89,34 |
| 5 | 69,51 | 91,67 |
| 6 | 72,31 | 93,21 |
| 7 | 74,69 | 94,40 |
| 8 | 76,71 | 95,33 |
| 9 | 78,49 | 96,13 |
| 10 | 80,04 | 96,78 |
| 11 | 81,40 | 97,30 |
| 12 | 82,59 | 97,71 |
| 13 | 83,66 | 98,04 |
| 14 | 84,61 | 98,33 |
| 15 | 85,47 | 98,59 |
| 16 | 86,24 | 98,81 |
| 17 | 86,93 | 99,01 |
| 18 | 87,55 | 99,19 |
| 19 | 88,11 | 99,36 |
| 20 | 88,62 | 99,50 |
| 21 | 89,10 | 99,63 |
| 22 | 89,54 | 99,75 |
| 23 | 89,96 | 99,83 |
| 24 | 90,36 | 99,89 |
| 25 | 90,75 | 99,93 |
| 26 | 91,12 | 99,96 |
| 27 | 91,48 | 100,00 |
| 28 | 91,84 | 100,00 |
| 29 | 92,18 | 100,00 |
| 30 | 92,52 | 100,00 |
| 31 | 92,86 | 100,00 |
| 32 | 93,18 | 100,00 |
| 33 | 93,49 | 100,00 |
| 34 | 93,80 | 100,00 |
| 35 | 94,10 | 100,00 |
| 36 | 94,38 | 100,00 |
| 37 | 94,67 | 100,00 |
| 38 | 94,94 | 100,00 |
| 39 | 95,20 | 100,00 |
| 40 | 95,45 | 100,00 |
| 41 | 95,71 | 100,00 |
| 42 | 95,96 | 100,00 |
| 43 | 96,19 | 100,00 |
| 44 | 96,43 | 100,00 |
| 45 | 96,60 | 100,00 |
| 46 | 96,80 | 100,00 |
| 47 | 96,90 | 100,00 |
| 48 | 97,00 | 100,00 |
| 49 | 97,20 | 100,00 |
| 50 | 97,28 | 100,00 |
| 51 | 97,47 | 100,00 |
| 52 | 97,65 | 100,00 |
| 53 | 97,82 | 100,00 |
| 54 | 97,98 | 100,00 |
| 55 | 98,13 | 100,00 |
| 56 | 98,27 | 100,00 |
| 57 | 98,40 | 100,00 |
| 58 | 98,52 | 100,00 |
| 59 | 98,63 | 100,00 |
| 60 | 98,73 | 100,00 |
| 61 | 98,82 | 100,00 |
| 62 | 98,90 | 100,00 |
| 63 | 98,97 | 100,00 |
| 64 | 99,03 | 100,00 |
| 65 | 99,09 | 100,00 |
| 66 | 99,14 | 100,00 |
| 67 | 99,18 | 100,00 |
| 68 | 99,22 | 100,00 |
| 69 | 99,25 | 100,00 |
| 70 | 99,28 | 100,00 |
| 71 | 99,30 | 100,00 |
| 72 | 99,33 | 100,00 |
| 73 | 99,36 | 100,00 |
| 74 | 99,38 | 100,00 |
| 75 | 99,41 | 100,00 |
| 76 | 99,43 | 100,00 |
| 77 | 99,46 | 100,00 |
| 78 | 99,48 | 100,00 |
| 79 | 99,51 | 100,00 |
| 80 | 99,54 | 100,00 |
| 81 | 99,56 | 100,00 |
| 82 | 99,59 | 100,00 |
| 83 | 99,61 | 100,00 |
| 84 | 99,64 | 100,00 |
| 85 | 99,66 | 100,00 |
| 86 | 99,69 | 100,00 |
| 87 | 99,72 | 100,00 |
| 88 | 99,74 | 100,00 |
| 89 | 99,77 | 100,00 |
| 90 | 99,79 | 100,00 |
| 91 | 99,82 | 100,00 |
| 92 | 99,84 | 100,00 |
| 93 | 99,87 | 100,00 |
| 94 | 99,89 | 100,00 |
| 95 | 99,92 | 100,00 |
| 96 | 99,94 | 100,00 |
| 97 | 99,96 | 100,00 |
| 98 | 99,97 | 100,00 |
| 99 | 99,99 | 100,00 |
| 100 | 99,99 | 100,00 |
- Lecture : 10 % des entreprises martiniquaises réalisent 80 % de la valeur ajoutée et 96,8 % de l’investissement.
- Source : Source : Insee – Esane 2014 (données individuelles).
graphiqueFigure 3 – Forte concentration de l’investissement et de la valeur ajoutéeConcentration de la valeur ajoutée et de l’investissement des entreprises martiniquaises en 2014

- Lecture : 10 % des entreprises martiniquaises réalisent 80 % de la valeur ajoutée et 96,8 % de l’investissement.
- Source : Source : Insee – Esane 2014 (données individuelles).
1 % des entreprises concentrent 46 % de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée des entreprises, principalement marchandes, non agricoles et non financières, est concentrée sur un nombre restreint d’entreprises du fait des faibles valeurs ajoutées réalisées par les 27 000 entreprises de moins de dix salariés (figure 4). Ainsi, en 2014, 1 % des entreprises ayant les plus fortes valeurs ajoutées rassemblent 46 % de valeur ajoutée (contre 65 % au niveau national) et 61 % de l’investissement (pour 84 % au niveau national). On y retrouve principalement 22 % des 990 entreprises de 10 à 249 salariés qui cumulent un milliard d’euros de valeur ajoutée. Les entreprises sans salarié ne contribuent qu’à hauteur de 5 % de la valeur ajoutée (72 millions d’euros).
tableauFigure 4 – La dispersion de la valeur ajoutée varie selon la taille de l’entrepriseDispersion de la valeur ajoutée des entreprises martiniquaises en 2014 (en millier d’euros)
| 1ᵉʳ quartile | médiane | 3ᵉ quartile | |
|---|---|---|---|
| 0 salarié | 2,607 | 12,043 | 30,800 |
| 1 à 9 salariés | 24,017 | 63,859 | 157,520 |
| 10 à 250 salariés | 154,487 | 540,047 | 1 117,970 |
| 250 et plus | 342,332 | 636,546 | 2 205,760 |
- Note : échelle logarithmique.
- Lecture : en 2014, 50 % des entreprises martiniquaises sans salarié ont une valeur ajoutée inférieure à 12 000 € (médiane), 25 % une valeur ajoutée inférieure à 3 000 € (1ᵉʳ quartile) et 25 % une valeur ajoutée supérieure à 31 000 € (3ᵉ quartile).
- Source : Insee – Esane 2014 (données individuelles).
graphiqueFigure 4 – La dispersion de la valeur ajoutée varie selon la taille de l’entrepriseDispersion de la valeur ajoutée des entreprises martiniquaises en 2014 (en millier d’euros)

- Note : échelle logarithmique.
- Lecture : en 2014, 50 % des entreprises martiniquaises sans salarié ont une valeur ajoutée inférieure à 12 000 € (médiane), 25 % une valeur ajoutée inférieure à 3 000 € (1ᵉʳ quartile) et 25 % une valeur ajoutée supérieure à 31 000 € (3ᵉ quartile).
- Source : Insee – Esane 2014 (données individuelles).
La valeur ajoutée augmente pour plus de la moitié des entreprises entre 2013 et 2014
En 2014, dans les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, le chiffre d’affaires des entreprises employeurs actives à la fois en 2013 et en 2014, progresse de 4 % par rapport à 2013 et la valeur ajoutée augmente de 8 %. Entre ces deux années, les plus grandes entreprises réalisent plus de croissance : la moitié des 35 entreprises de 250 salariés ou plus augmentent leur valeur ajoutée de plus de 50 %. L’évolution médiane est également positive pour la moitié des 770 entreprises de 10 à 249 salariés, mais dans une moindre mesure (+ 5 %).
Investissement médian nul pour les entreprises sans salarié
Les montants investis par les petites entreprises sont faibles, en lien avec le niveau de leur activité. Au-delà des spécificités liées au secteur d’activité, si une partie importante des petites sociétés n’investit pas, cela est souvent lié à une contrainte économique. Ainsi, l’excédent brut d’exploitation, qui permet notamment de financer l’investissement, est nettement plus faible pour les sociétés non investisseuses. Ceci peut écarter toute possibilité d’investir par l’autofinancement ou via l’endettement, l’obtention d’un prêt étant plus difficile dans ces conditions. En 2014, deux entreprises sans salarié sur dix ont investi : pour la moitié d’entre elles, l’investissement est inférieur à 4 000 euros, et pour le reste il est inférieur à 250 000 euros. Le montant médian investi par les entreprises de 1 à 9 salariés est de mille euros (figure 5), dix fois moins que celui des unités de 10 à 250 salariés.
tableauFigure 5 – Forte dispersion de l’investissement pour les entreprises de plus de 250 salariésDispersion de l’investissement des entreprises martiniquaises en 2014 (en millier d’euros)
| 1ᵉʳ quartile | médiane | 3ᵉ quartile | |
|---|---|---|---|
| 0 salarié | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 à 9 salariés | 0,000 | 0,550 | 4,668 |
| 10 à 250 salariés | 1,705 | 10,503 | 46,379 |
| 250 salariés et plus | 56,467 | 115,343 | 181,733 |
- Lecture : en 2014, 50 % des entreprises martiniquaises de 10 à 249 salariés ont investi moins de 11 000 € (médiane), 25 % ont investi moins de 2 000 € (1ᵉʳ quartile) et 25 % ont investi plus de 46 000 € (3ᵉ quartile).
- Source : Insee – Esane 2014 (données individuelles).
graphiqueFigure 5 – Forte dispersion de l’investissement pour les entreprises de plus de 250 salariésDispersion de l’investissement des entreprises martiniquaises en 2014 (en millier d’euros)

- Lecture : en 2014, 50 % des entreprises martiniquaises de 10 à 249 salariés ont investi moins de 11 000 € (médiane), 25 % ont investi moins de 2 000 € (1ᵉʳ quartile) et 25 % ont investi plus de 46 000 € (3ᵉ quartile).
- Source : Insee – Esane 2014 (données individuelles).
Sources
L’élaboration des statistiques annuelles d’entreprise (Esane) est le système d’information qui permet d’élaborer les statistiques structurelles d’entreprises françaises, à destination à la fois des autorités politiques et administratives françaises (sous l’égide du Cnis), de la Commission européenne (Eurostat), des statisticiens français et en particulier des comptables nationaux. Le dispositif Esane combine des données administratives (déclarations annuelles de bénéfices des entreprises et données annuelles de données sociales) et des données obtenues à partir d’un échantillon d’entreprises enquêtées par un questionnaire spécifique pour produire des statistiques structurelles d’entreprises (enquête sectorielle annuelle (ESA)). Mis en place en 2009 sur l’exercice 2008, ce dispositif remplace le précédent système composé de deux dispositifs avec les enquêtes annuelles d’entreprise (EAE) et le système unifié de statistiques d’entreprises (Suse) s’appuyant sur les déclarations fiscales, en les unifiant. Le champ d’Esane est celui des entreprises marchandes à l’exception du secteur financier et des exploitations agricoles. Ce champ est défini à partir des codes de la nomenclature d’activité NAF. Les soldes comptables présentés dans cette étude sont calculés à partir d’Esane.
Définitions
L’excédent brut d’exploitation (EBE) n’est pas seulement la rémunération des apporteurs de capitaux ou le bénéfice de l’entreprise. Il permet de rémunérer les actionnaires, mais également de rembourser les dettes ou de financer des investissements. Il rémunère également le travail des entrepreneurs individuels.
Comprendre les soldes comptables
Le chiffre d’affaires se compose de la production vendue de biens et services et les ventes de marchandises. Les marchandises ne sont pas une production réalisée par l’entreprise qui les commercialise, contrairement aux productions vendues de biens ou services. Contrairement au chiffre d’affaires, la valeur ajoutée hors taxes correspond à ce qui est vraiment créé par l’entreprise. Elle s’obtient en additionnant le chiffre d’affaires, la production stockée et les autres produits d’exploitation, auxquels sont retranchées les consommations intermédiaires, les charges d’exploitation et la variation de stock. Les valeurs ajoutées peuvent s’additionner car les consommations intermédiaires sont soustraites. Transformées, ces consommations permettent la production d’autres biens ou services ou la vente de marchandises. Certains secteurs d’activités bénéficient de subventions. Les entreprises sont également taxées. La valeur ajoutée au coût des facteurs de production s’obtient en ajoutant à la valeur ajoutée les subventions et en retranchant les impôts et taxes. La valeur ajoutée au coût des facteurs de production se divise en deux parties :
- les frais de personnel qui permettent la rémunération du facteur de production « travail » ;
- l’excédent brut d’exploitation qui s’interprète comme le revenu du facteur de production « capital ».
Le taux de valeur ajoutée
Le taux de valeur ajoutée mesure la performance de l’outil de production, le degré d’intégration ou de sous-traitance d’une entreprise dans une filière de production. Plus ce taux est élevé, plus l’entreprise contribue à créer de la valeur et plus elle est intégrée dans le tissu économique. Une entreprise qui réalise en interne l’ensemble de la chaîne de production aura un taux de valeur ajoutée plus important que celle qui sous-traite certaines étapes, à chiffre d’affaires égal. Taux faible : peu de main-d’œuvre, processus court, activité commerciale. Taux élevé : part importante de la main-d’œuvre dans les processus, activité de services.
Le taux de marge
La valeur ajoutée au coût des facteurs de production (y compris les subventions d’exploitation, hors impôts et taxes d’exploitation) permet aux entreprises de payer les frais de personnel et de dégager un excédent brut d’exploitation… Le taux de marge est le rapport de l’EBE sur la valeur ajoutée aux coûts des facteurs de production (VACF). La comparaison des taux de marge entre secteurs est un exercice délicat. Chaque secteur présente en effet des particularités vis-à-vis du recours à l’emploi et au capital et du cycle conjoncturel. Les secteurs capitalistiques ont de fait un taux de marge plus élevé que les secteurs de main-d’œuvre. Dans le partage de la VACF, le taux de marge rend compte de ce qui reste à disposition des entreprises, l’EBE notamment, pour rémunérer le capital, une fois déduites les rémunérations salariales. Un taux de marge élevé résulte en général de la mise en œuvre d’un capital d’exploitation important ; il n’implique pas nécessairement une rentabilité économique forte (l’EBE devant alors être rapporté à ce capital d’exploitation) mais sert à financer les investissements. La taille des entreprises, mesurée par l’effectif salarié, influe sur les taux de marge. Le taux de marge est plus élevé en règle générale dans les entreprises de moins de dix salariés que dans les autres. Les micro entreprises intègrent des travailleurs individuels indépendants (commerçants, artisans, professions libérales), et des gérants majoritaires de SARL, qui ne sont pas salariés mais rémunèrent leur travail sur le résultat de l’entreprise. Le taux de marge s’en trouve augmenté mécaniquement. Or, les micro entreprises sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses aux Antilles-Guyane qu’en France. La comparaison des taux de marge n’est donc juste qu’à structure équivalente.
Champ
Le champ étudié : les secteurs principalement marchands
Le champ étudié dans cet article est celui des entreprises des secteurs économiques principalement marchands, y compris auto-entrepreneurs, à l’exception des entreprises du secteur financier (observées par l’Autorité de contrôle prudentiel), des exploitations agricoles (couvertes par de nombreuses enquêtes gérées par le service statistique du ministère de l’Agriculture).
Les biens et services marchands sont destinés normalement à être vendus sur le marché à un prix calculé pour couvrir leur coût de production. Une unité économique rend des services non marchands lorsqu’elle les fournit gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs. Certains services sont considérés comme toujours marchands (exemple, les transports), d’autres comme toujours non marchands (exemple, administration générale).
Pour certaines activités, des parties marchandes et non-marchandes coexistent. Ces activités de services se rencontrent dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’action sociale et de l’administration. Ainsi, les entreprises du secteur de « l’enseignement, santé humaine et action sociale » ne sont pas prises en compte dans cette étude : le champ étudié est celui des secteurs économiques principalement marchands.
Pour en savoir plus
Benhaddouche A., « Activité en berne pour les entreprises guadeloupéennes en 2014 », Insee Analyses Guadeloupe n° 28, mars 2018.
Benhaddouche A., « En 2014, le secteur industriel maintient son niveau d’activité », Insee Analyses Guyane n° 28, mars 2018.



