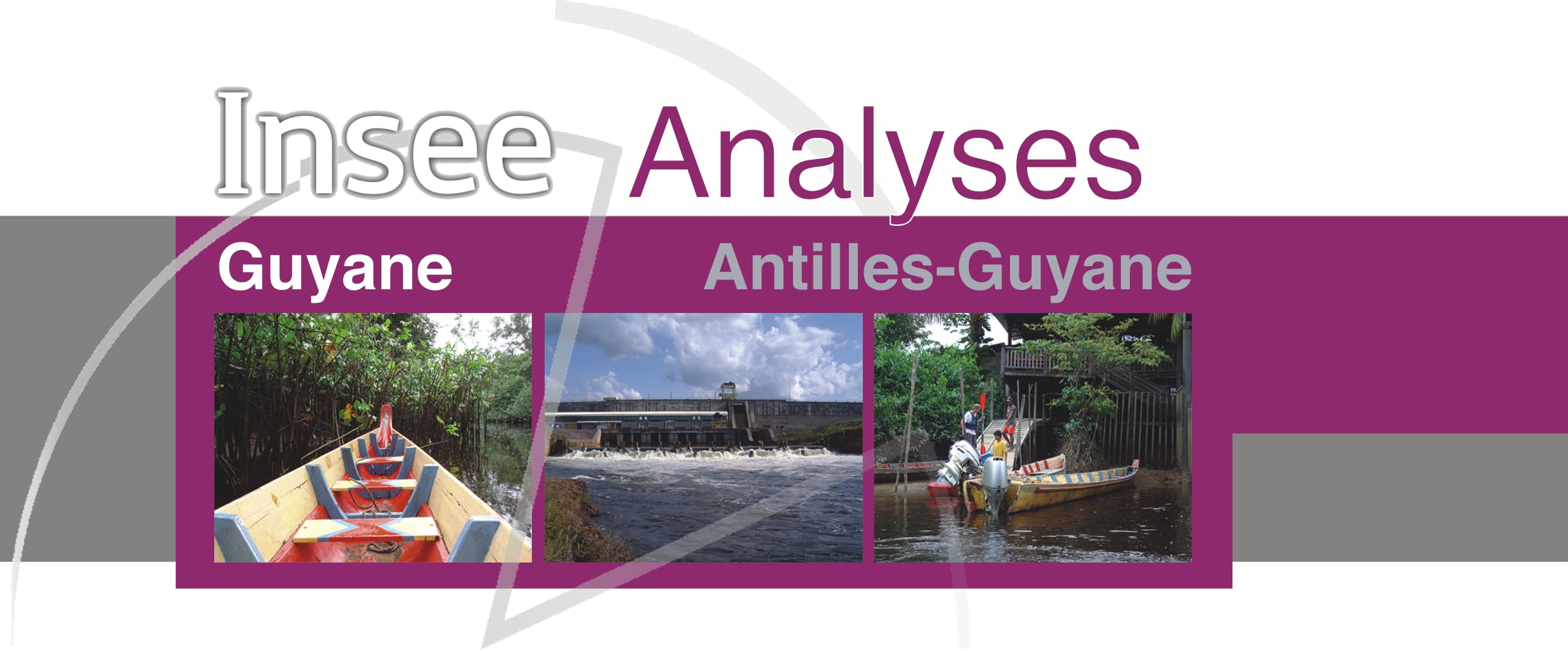 En 2011, le secteur marchand guyanais génère un tiers des richesses produites sur
le territoire
En 2011, le secteur marchand guyanais génère un tiers des richesses produites sur
le territoire
Avec 1,2 milliard d’euros de richesses créées, la situation économique de la Guyane reste dynamique en 2011. La croissance démographique favorise l’essor du tissu productif. Le secteur marchand guyanais est dominé par les activités tertiaires notamment commerciales, mais le secteur industriel continue à se développer. La filière spatiale continue d’exercer un effet d’entraînement, notamment sur les secteurs de l’industrie, des services aux entreprises et du transport. En 2011, le secteur de la construction est également un moteur pour l’économie de la région, occupant le premier rang en terme de création de richesses.
- La construction, premier secteur créateur de richesses…
- …qui devance de peu le secteur du commerce
- Les services spécialisés aux entreprises, troisième secteur créateur de richesses
- Le développement du tourisme d’affaire favorise l’activité de l’hôtellerie restauration
- Les consommations intermédiaires représentent 70 % du chiffre d’affaires
- Les entreprises guyanaises réalisent un taux de marge de 39 % en 2011
- Le champ étudié : le secteur marchand
De par son dynamisme démographique, l’économie guyanaise est plus orientée vers sa demande interne qu’externe et se trouve ainsi protégée des fluctuations nationales, voire internationales. La forte croissance démographique permet l’essor du tissu productif et nécessite, en matière d’équipement du territoire, de nombreux investissements.
En 2011, la valeur ajoutée des entreprises guyanaises du secteur marchand atteint 1,2 milliard d’euros. Les richesses ainsi produites par ce secteur représentent un tiers des richesses totales produites en Guyane, poids nettement inférieur à celui du niveau national (57 %). Ce poids en constante progression depuis plusieurs années confirme le développement du secteur marchand guyanais.
L’année 2011 est une année faste pour l’activité spatiale, avec sept lancements réussis et le développement des offres de lancement d’Arianespace. Cette dernière dispose d’une gamme complète de services, avec le nouveau Soyouz et la mise en place de Vega, le lanceur européen opérationnel début 2012.
Le secteur du spatial a un effet d’entraînement sur plusieurs secteurs d’activité tels que le secteur industriel, celui des services aux entreprises et également celui du transport. Le secteur de la construction reste dynamique, les besoins en logements et l’aménagement du territoire étant toujours prégnants. À titre de comparaison en 2011, la valeur ajoutée dégagée par les entreprises guadeloupéennes du secteur marchand s’élève à 2,9 milliards d’euros et celles implantées en Martinique à 3,2 milliards d’euros.
tableauFigure 1 – Des consommations intermédiaires importantes dans le commerce
| Secteur d'activité | Valeur ajoutée hors taxes - production stockée - produits d'exploitation | Consommation intermédiaire (hors achats) | achats de marchandises |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 31,1 | 40,8 | 28,0 |
| Commerce | 16,5 | 12,5 | 71,0 |
| Construction | 31,9 | 67,9 | 0,2 |
| Industrie manufacturière,| industries extractives et autres | 33,8 | 64,4 | 1,9 |
| Transports et entreposage | 34,5 | 61,1 | 4,5 |
| Hébergement et restauration | 34,9 | 64,8 | 0,2 |
| Information et communication | 36,8 | 61,4 | 1,9 |
| Autres activités de services | 41,8 | 48,0 | 10,2 |
| Activités spécialisées,| scientifiques et techniques, ... | 54,1 | 43,7 | 2,2 |
| Enseignement, santé| humaine et action sociale | 63,4 | 36,5 | 0,1 |
| Activités immobilières | 73,7 | 25,0 | 1,3 |
- Source : Insee - Esane 2011 - Données individuelles.
graphiqueFigure 1 – Des consommations intermédiaires importantes dans le commerce Décomposition du chiffre d’affaires des entreprises implantées en Guyane selon les secteurs d’activité en 2011 (en %)

- Source : Insee - Esane 2011 - Données individuelles.
La construction, premier secteur créateur de richesses…
En 2011, les richesses créées par ce secteur représentent 22 % des richesses produites sur le territoire. La croissance démographique très forte nécessite la construction de nouveaux logements, notamment des logements sociaux (zone de Soula), et d’aménagement du territoire (usine de traitement d’eau potable Matiti, réhabilitation du quai n° 2 du port de Degrad-des-Cannes).
La commande publique reste le principal soutien de ce secteur, représentant entre 50 % du chiffre d’affaires du bâtiment et 80 % des travaux publics. Mais le secteur privé semble devenir un relais de croissance en termes de demande. En 2011, encouragées par les mesures de défiscalisation, les autorisations de logements dans le secteur privé sont quatre fois plus nombreuses que celles de logements sociaux. En 2010, les autorisations de ces deux secteurs étaient équivalentes. Toutefois, la construction de logements sociaux est une activité cyclique et des opérations importantes ont été réalisées en 2010 à Saint-Laurent du Maroni, Macouria, Cayenne ou Rémire-Montjoly, avec pour certaines une livraison début 2011.
Le maintien de l’activité de la construction en 2011 avec une nette accélération en fin d’année le place au premier rang, en termes de création de richesses, devançant de peu le secteur du commerce. La valeur ajoutée dégagée par la construction est deux fois plus importante dans l’économie guyanaise que dans les économies guadeloupéenne et martiniquaise.
…qui devance de peu le secteur du commerce
L’activité du secteur commercial en 2011 a été de bonne tenue. La valeur ajoutée générée par le secteur du commerce représente 20 % de la valeur ajoutée totale. Cette prépondérance du commerce dans l’économie guyanaise se retrouve également dans les économies guadeloupéenne et martiniquaise. Le commerce de gros dégage un peu plus de richesses que le commerce de détail, comportement inverse à celui enregistré en Guadeloupe.
La croissance démographique est génératrice de besoins de plus en plus importants en termes de consommation et incite le secteur du commerce à s’organiser pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs guyanais. Le secteur est engagé depuis plusieurs années dans une phase de restructuration autour de quelques groupes qui se positionnent sur tout l’éventail de la distribution (grossistes, hypermarchés, supermarchés et supérettes).
L’arrivée d’un nouvel hypermarché, en juillet 2011 est l’événement marquant de cette année. La surface commerciale totale de la Guyane (hors galeries marchandes) augmente de 7,6 %.
Les services spécialisés aux entreprises, troisième secteur créateur de richesses
Avec 17 % des richesses totales, le secteur des services spécialisés aux entreprises s’est fortement développé au cours des dernières années. Toutefois, ces entreprises sont encore peu nombreuses par rapport à la demande. La filière spatiale a un effet d’entraînement important sur ce secteur. De même, l’activité grandissante du secteur de la construction génère également des besoins notamment dans les activités d’architecture et d’ingénierie, stimulant ainsi leurs développements. Par ailleurs 55 % de la valeur ajoutée du secteur des services aux entreprises est générée par les activités de services administratifs et de soutien (intérim, sécurité). Dans l’économie martiniquaise, les richesses produites par ce secteur représentent 20 % des richesses totales (15 % dans l’économie guadeloupéenne).
tableauFigure 2 – La construction et le commerce génèrent plus de 40 % des richesses - Principaux résultats des entreprises implantées en Guyane en 2011
| Secteur d'activité | Nombre d'unités | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée | Part de la VA dans l'ensemble (%) | Excédent brut d'exploitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 867 | 472 386 | 164 870 | 13,8 | 61 516 |
| - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 176 | 56 675 | 17 374 | 1,5 | 7 664 |
| - Industrie chimique | 20 | 73 675 | 29 251 | 2,5 | 13 409 |
| Construction | 1 387 | 804 053 | 266 430 | 22,3 | 83 853 |
| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 3 026 | 1 778 074 | 358 964 | 30,1 | 134 098 |
| - Commerce : | 2 038 | 1 440 117 | 241 008 | 20,2 | 93 109 |
| dont commerce de gros, hors automobiles et motocycles | 356 | 674 034 | 118 530 | 9,9 | 52 796 |
| dont commerce de détail, hors automobiles et motocycles | 1 472 | 567 824 | 95 013 | 8,0 | 34 132 |
| - Transports et entreposage | 420 | 156 637 | 54 233 | 4,5 | 18 374 |
| - Hébergement et restauration | 568 | 181 319 | 63 723 | 5,3 | 22 615 |
| Information et communication | 163 | 68 739 | 26 089 | 2,2 | 8 172 |
| Activités immobilières | 182 | 94 979 | 70 655 | 5,9 | 51 276 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 1 245 | 368 654 | 202 305 | 17,0 | 70 174 |
| - Activités de services administratifs et de soutien | 546 | 222 691 | 113 117 | 9,5 | 24 873 |
| Enseignement, santé humaine et action sociale | 650 | 148 251 | 94 652 | 7,9 | 52 201 |
| - Activités pour la santé humaine | 529 | 118 884 | 75 621 | 6,3 | 48 387 |
| Autres activités de services | 420 | 21 685 | 9 443 | 0,8 | 825 |
| Ensemble | 7 940 | 3 756 820 | 1 193 408 | 100,0 | 462 114 |
- Source : Insee – Esane 2011 - Données individuelles.
Le développement du tourisme d’affaire favorise l’activité de l’hôtellerie restauration
L’élargissement de l’offre et la fréquentation hôtelière permettent une activité soutenue du secteur de l’hôtellerie et la restauration. Les lancements d’Arianespace, notamment les deux premiers tirs Soyouz et l’ATV (Automated Transfer Vehicle ; véhicule automatique de transfert européen) ont accru le tourisme d’affaires. Cela a contribué au redémarrage des investissements dans l’hôtellerie après une longue période atone. Le poids de ce secteur dans la valeur ajoutée totale des services marchands est de 5 %, poids identique en Guadeloupe et Martinique.
L’industrie représente 14 % de la valeur ajoutée totale guyanaise (20 % en Martinique et 14 % en Guadeloupe). Le poids relativement faible de l’industrie s’explique, notamment, par la faible présence des industries agroalimentaires dans le département. Ce secteur, comme l’ensemble de l’économie guyanaise, est en effet confronté à un certain nombre de contraintes difficiles à lever pour pouvoir assurer la pérennité des entreprises ; la faible taille du marché induit l’absence d’économies d’échelle, des coûts élevés et donc une faible compétitivité. Seules quelques unités artisanales ou petites industries transforment et conditionnent les produits régionaux.
Les consommations intermédiaires représentent 70 % du chiffre d’affaires
Après deux années de relative stabilité, le retour en 2011 de la hausse des prix en Guyane a renchérit le coût des consommations intermédiaires (y compris les achats de marchandises) pour les entreprises. Celles-ci représentent 70 % du chiffre d’affaires des entreprises des différents secteurs du service marchand guyanais, proportion quasi identique pour les entreprises guadeloupéennes et martiniquaises.
Cependant, la part des consommations intermédiaires dans le processus de production est variable selon les secteurs économiques. Par exemple, les activités de services, peu consommatrices de produits intermédiaires, affichent des taux de valeur ajoutée supérieurs à 40 %. Les secteurs de l’enseignement, santé humaine et action sociale et les activités spécialisées, scientifiques et techniques et les activités immobilières en sont une illustration, avec un taux de valeur ajoutée d’au moins 55 %. À l’opposé dans des secteurs comme l’industrie ou la construction, grands consommateurs de produits intermédiaires, le taux de valeur ajoutée représente moins de 35 % du chiffre d’affaires. Le commerce, secteur où les achats de marchandises représentent 75 % du chiffre d’affaires, affiche le taux de valeur ajoutée le plus bas (16 %).
Les entreprises guyanaises réalisent un taux de marge de 39 % en 2011
Le taux de marge des entreprises guyanaises est en moyenne de 39 % en 2011. Le taux de marge des entreprises varie selon le secteur d’activité. Le taux de marge est généralement élevé dans les secteurs où la productivité apparente du capital est faible. Le secteur des activités immobilières se caractérise par un niveau d’investissement élevé (biens immobiliers…). Ce niveau d’investissements doit relativiser un taux de marge élevé. À l’inverse, le taux de marge indique que le secteur des activités de services administratifs (22 %) emploie moins de capital par rapport au travail qu’un secteur où le taux de marge est plus élevé, comme la santé humaine (64 %). Enfin, les secteurs les moins rentables sont souvent des secteurs concurrentiels : soit l’offre y est atomistique (hôtels-restaurants, services personnels), soit leurs produits sont banalisés (biens intermédiaires).
tableauFigure 3 – Des taux de marge supérieurs à la moyenne dans le commerce de gros et les IAA - Quelques ratios d’analyse financière des entreprises implantées en Guyane par secteur d’activité en 2011 (en %)
| Secteur d'activité | Taux de Valeur ajoutée VA H.T./CA | Taux de marge EBE/VACF | Part des frais de personnel FP/VACF |
|---|---|---|---|
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 34,9 | 37,3 | 62,7 |
| - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 30,7 | 44,1 | 55,9 |
| - Industrie chimique | 39,7 | 45,8 | 54,2 |
| Construction | 33,1 | 31,5 | 68,5 |
| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 20,2 | 37,4 | 62,6 |
| - Commerce : | 16,7 | 38,6 | 61,4 |
| dont commerce de gros, hors automobiles et motocycles | 17,6 | 44,5 | 55,5 |
| dont commerce de détail, hors automobiles et motocycles | 16,7 | 35,9 | 64,1 |
| - Transports et entreposage | 34,6 | 33,9 | 66,1 |
| - Hébergement et restauration | 35,1 | 35,5 | 64,5 |
| Information et communication | 38,0 | 31,3 | 68,7 |
| Activités immobilières | 74,4 | 72,6 | 27,4 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 54,9 | 34,7 | 65,3 |
| - Activités de services administratifs et de soutien | 50,8 | 22,0 | 78,0 |
| enseignement, santé humaine et action sociale | 63,8 | 55,2 | 44,8 |
| - Activités pour la santé humaine | 63,6 | 64,0 | 36,0 |
| Autres activités de services | 43,5 | 8,7 | 91,3 |
| Ensemble | 31,8 | 38,7 | 61,3 |
- Source : Insee - Esane 2011 - Données individuelles.
tableauFeuil1 – L’Excédent brut d’exploitation représente 40 % de la VA dans le commerce
| Secteur d'activité | Excédent brut d'exploitation | Frais de personnel |
|---|---|---|
| Ensemble | 38,7 | 61,3 |
| Activités immobilières | 72,6 | 27,4 |
| Enseignement, santé| humaine et action sociale | 55,2 | 44,8 |
| Commerce | 38,6 | 61,4 |
| Industrie manufacturière,| industries extractives| et autres | 37,3 | 62,7 |
| Hébergement et restauration | 35,5 | 64,5 |
| Activités spécialisées,| scientifiques et techniques … | 34,7 | 65,3 |
| Transports et entreposage | 33,9 | 66,1 |
| Construction | 31,5 | 68,5 |
| Information et communication | 31,3 | 68,7 |
| Autres activités de services | 8,7 | 91,3 |
- Source : Insee - Esane 2011 - données individuelles
graphiqueFeuil1 – L’Excédent brut d’exploitation représente 40 % de la VA dans le commerceRépartition de la valeur ajoutée des entreprises implantées en Guyane selon le coût des facteurs de production en 2011 (en %)

- Source : Insee - Esane 2011 - données individuelles
Le champ étudié : le secteur marchand
Le champ étudié dans cet article est celui des entreprises marchandes, y compris auto-entrepreneurs, à l’exception des entreprises du secteur financier (observées par l’Autorité de contrôle prudentiel) et des exploitations agricoles (couvertes par de nombreuses enquêtes gérées par le service statistique du ministère de l’Agriculture).
Les biens et services marchands sont destinés normalement à être vendus sur le marché à un prix calculé pour couvrir leur coût de production.
En toute rigueur, il faudrait parler de services principalement marchands car pour certaines activités coexistent des parties marchandes et non-marchandes ; certains services sont considérés comme toujours marchands (exemple les transports), d’autres comme toujours non marchands (exemple administration générale).
On considère qu’une unité économique rend des services non marchands lorsqu’elle les fournit gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs. Ces activités de services se rencontrent dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’action sociale et de l’administration. Ainsi dans le secteur de « l’enseignement, santé humaine et action sociale » ne sont prises en compte dans cette étude que les entreprises du secteur marchand, hors secteur public : il s’agit donc d’une vision très partielle du poids économique réel de ces activités.
Sources
Source
L’élaboration des statistiques annuelles d’entreprise (Esane) est le système d’information qui permet d’élaborer les statistiques structurelles d’entreprises françaises, à destination à la fois des autorités politiques et administratives françaises (sous l’égide du Cnis), de la Commission européenne (Eurostat), des statisticiens français et en particulier des comptables nationaux.
Le dispositif Esane combine des données administratives (déclarations annuelles de bénéfices des entreprises et données annuelles de données sociales) et des données obtenues à partir d’un échantillon d’entreprises enquêtées par un questionnaire spécifique pour produire des statistiques structurelles d’entreprises (enquête sectorielle annuelle (ESA)).
Mis en place en 2009 sur l’exercice 2008, ce dispositif remplace le précédent système composé de deux dispositifs avec les enquêtes annuelles d’entreprise (EAE) et le système unifié de statistiques d’entreprises (Suse) s’appuyant sur les déclarations fiscales, en les unifiant.
Le champ d’Esane est celui des entreprises marchandes à l’exception du secteur financier et des exploitations agricoles. Ce champ est défini à partir des codes de la nomenclature d’activité NAF.
Les soldes comptables présentés dans cette étude sont calculés à partir d’Esane.
Avertissement
Cette étude utilise des données administratives exhaustives (liasses fiscales). En 2011, une nouvelle méthode d’imputation des liasses fiscales a été introduite rendant délicate la comparaison avec 2010. Pour cette raison, les évolutions entre 2010 et 2011 ne sont pas publiées.
Définitions
Comprendre les soldes comptables :
Le chiffre d’affaires se compose de la production vendue de biens et services et les ventes de marchandises. Les marchandises ne sont pas une production réalisée par l’entreprise qui les commercialise, contrairement aux productions vendues de biens ou services.
Contrairement au chiffre d’affaires, la valeur ajoutée hors taxes correspond à ce qui est vraiment créé par l’entreprise. Elle s’obtient en additionnant le chiffre d’affaires, la production stockée et les autres produits d’exploitation, auxquels sont retranchées les consommations intermédiaires, les charges d’exploitation et la variation de stock. Les valeurs ajoutées peuvent s’additionner car les consommations intermédiaires sont soustraites. Transformées, ces consommations permettent la production d’autres biens ou services ou la vente de marchandises.
Certains secteurs d’activités bénéfi cient de subventions. Les entreprises sont également taxées. La valeur ajoutée au coût des facteurs de production s’obtient en ajoutant à la valeur ajoutée les subventions et en retranchant les impôts et taxes.
La valeur ajoutée au coût des facteurs de production se divise en deux parties :
- les frais de personnel qui permettent la rémunération du facteur de production « travail » ;
- l’excédent brut d’exploitation qui s’interprète comme le revenu du facteur de production « capital ».
L’excédent brut d’exploitation (EBE) n’est pas seulement la rémunération des apporteurs de capitaux ou le bénéfice de l’entreprise. Il permet de rémunérer les actionnaires, mais également de rembourser les dettes ou de financer des investissements. Il rémunère également le travail des entrepreneurs individuels.
Le taux de valeur ajoutée :
Le taux de valeur ajoutée mesure la performance de l’outil de production, le degré d’intégration ou de sous-traitance d’une entreprise dans une filière de production. Plus ce taux est élevé, plus l’entreprise contribue à créer de la valeur et plus elle est intégrée dans le tissu économique. Une entreprise qui réalise en interne l’ensemble de la chaîne de production aura un taux de valeur ajoutée plus important que celle qui sous-traite certaines étapes, à chiffre d’affaires égal.
Taux faible : peu de main d’œuvre, processus court, activité commerciale.
Taux élevé : part importante de la main d’œuvre dans les processus, activité de services.
Le taux de marge :
La valeur ajoutée au coût des facteurs de production (y compris les subventions d’exploitation, hors impôts et taxes d’exploitation) permet aux entreprises de payer les frais de personnel et de dégager un excédent brut d’exploitation... Le taux de marge est le rapport de l’EBE sur la valeur ajoutée aux coûts des facteurs de production (VACF). La comparaison des taux de marge entre secteurs est un exercice délicat. Chaque secteur présente en effet des particularités vis-à-vis du recours à l’emploi et au capital et du cycle conjoncturel. Les secteurs capitalistiques ont de fait un taux de marge plus élevé que les secteurs de main-d’oeuvre.
Dans le partage de la VACF, le taux de marge rend compte de ce qui reste à disposition des entreprises, l’EBE notamment, pour rémunérer le capital, une fois déduites les rémunérations salariales. Un taux de marge élevé résulte en général de la mise en oeuvre d’un capital d’exploitation important ; il n’implique pas nécessairement une rentabilité économique forte (l’EBE devant alors être rapporté à ce capital d’exploitation) mais sert à financer les investissements.
La taille des entreprises, mesurée par l’effectif salarié, infl ue sur les taux de marge. Le taux de marge est plus élevé en règle générale dans les entreprises de moins de dix salariés que dans les autres. Les microentreprises intègrent des travailleurs individuels indépendants (commerçants, artisans, professions libérales), et des gérants majoritaires de SARL, qui ne sont pas salariés mais rémunèrent leur travail sur le résultat de l’entreprise. Le taux de marge s’en trouve augmenté mécaniquement. Or, les microentreprises sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses aux Antilles-Guyane qu’en France. La comparaison des taux de marge n’est donc juste qu’à structure équivalente.
Pour en savoir plus
Brion P., « Esane, le dispositif rénové de production des statistiques structurelles d’entreprises », Courrier des statistiques n° 130, mai 2011.
Picard C., « Rentabilités d’exploitation sectorielles - La construction et l’industrie pharmaceutique en tête en 2001 », Insee Première n° 989, octobre 2004.
Millet C., « En 2011, les richesses créées par le secteur marchand guadeloupéen atteignent 2,9 milliards d’euros », Insee Analyse Guadeloupe n° 14, novembre 2016.
Benhaddouche A., « En 2011, le secteur marchand martiniquais génère 40 % de la richesse produite sur le territoire », Insee Analyse Martinique n° 12, novembre 2016.



