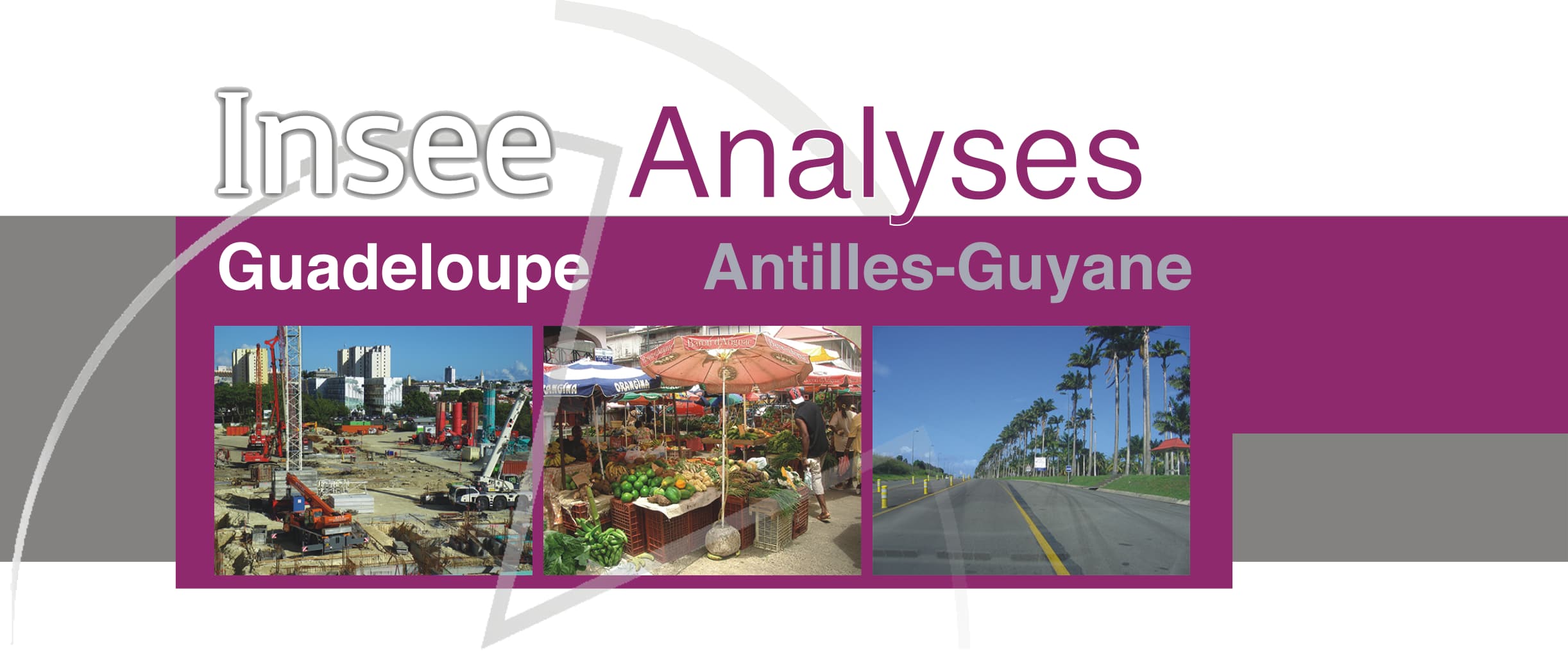 En 2011, les richesses créées par le secteur marchand guadeloupéen atteignent 2,9
milliards d’euros
En 2011, les richesses créées par le secteur marchand guadeloupéen atteignent 2,9
milliards d’euros
Le secteur marchand guadeloupéen est l’un des premiers contributeurs à la création de richesses dans l’économie régionale. En 2011, le montant des richesses créées par ce secteur atteint 2,9 milliards d’euros dont plus d’un quart émane du seul secteur du commerce, qui, cette année, a bénéficié du dynamisme de la consommation des ménages. Pénalisé par l’absence de grands chantiers de travaux publics et une forte baisse du nombre de constructions de logements individuels, le secteur de la construction déprime. En 2011, l’économie guadeloupéenne présente une évolution contrastée qui ne permet pas de conclure à une reprise durable de l’économie de la région.
La valeur ajoutée générée par les entreprises1 guadeloupéennes du secteur marchand s’élève à 2,9 milliards d’euros en 2011. Quant aux secteurs marchands martiniquais et guyanais, les richesses produites atteignent respectivement 3,1 milliards d’euros et 1,2 milliard d’euros. Les signes de reprise de l’économie guadeloupéenne, enregistrés fin 2010, se poursuivent en 2011. Toutefois, un léger tassement de cette reprise est visible au 3e trimestre avec une activité économique atone, due notamment à un repli de la consommation des ménages et aux tensions persistantes du marché du travail. Le contexte économique étant jugé incertain, les entreprises deviennent frileuses et préfèrent reporter certains investissements.
La structure de l’économie guadeloupéenne se démarque par un secteur tertiaire très prégnant et un nombre très important de petites entreprises. En effet, huit entreprises sur dix sont sans salarié.
tableauFigure 1 – Les secteurs grands consommateurs de consommation intermédiaire affichent des taux de valeur ajouté bas
| Valeur ajoutée H.T.-prod. stockée-produits d'exploitation | Consommations intermédiaires (hors achats) | Achats de marchandises | |
|---|---|---|---|
| ensemble | 25,3 | 36,8 | 37,9 |
| Commerce | 14,3 | 12,0 | 73,7 |
| Construction | 25,0 | 75,0 | 0,0 |
| Transports et entreposage | 25,9 | 73,9 | 0,2 |
| Industrie manufacturière,|industries extractives et autres | 27,8 | 64,4 | 7,8 |
| Hébergement et restauration | 39,7 | 58,0 | 2,3 |
| Information et communication | 45,1 | 51,2 | 3,7 |
| Activités spécialisées,|scientifiques et techniques, ... | 45,4 | 50,2 | 3,2 |
| Autres activités de services | 47,7 | 46,6 | 5,7 |
| Activités immobilières | 47,7 | 46,6 | 5,7 |
| Enseignement, santé humaine|et action sociale | 63,4 | 36,0 | 0,6 |
- Source : Insee - Esane 2011 - Données individuelles
graphiqueFigure 1 – Les secteurs grands consommateurs de consommation intermédiaire affichent des taux de valeur ajouté basDécomposition du chiffre d’affaires des entreprises implantées en Guadeloupe selon les secteurs d’activité en 2011 (en %)

- Source : Insee - Esane 2011 - Données individuelles
Le commerce conforte sa place de leader en générant près de 800 millions d’euros de valeur ajoutée
La valeur ajoutée générée par le secteur du commerce (hors automobile et motocycle) avoisine 800 millions d’euros pour l’année 2011, ce qui place ce secteur en position de leader. Ce secteur occupe la première place dans les économies martiniquaise et guyanaise mais avec une proportion légèrement moins marquée. Plus de la moitié des richesses créées par le secteur du commerce proviennent du commerce de détail, qui regroupe près de sept établissements commerciaux sur dix. L’industrie guadeloupéenne, de par son insularité, son éloignement géographique et l’étroitesse de son marché potentiel, est peu présente dans le tissu économique de la région. Après avoir connu un repli en 2010, la valeur ajoutée de ce secteur représente 14 % de la valeur ajoutée des services marchands guadeloupéens, part plus faible qu’en Martinique (20 %). C’est le secteur de l’agroalimentaire qui crée la plus grande part des richesses du secteur de l’industrie. La part de la valeur ajoutée générée par le secteur de la construction avoisine 10 %. Après un effondrement en 2009, ce secteur avait amorcé une reprise en 2010. Cette reprise ne s’est pas véritablement poursuivie en 2011, même si l’on note une amélioration au second semestre. Cela s’explique par le manque de grands chantiers dans le domaine des travaux publics et le manque de dynamisme des constructions de maisons privées. Les nouveaux dispositifs de défiscalisation mis en œuvre pour la construction de logements sociaux permettent de maintenir une activité dans ce secteur. Le secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques et les services administratifs et de soutien crée près de 15 % des richesses totales du secteur marchand guadeloupéen. En Martinique, ce secteur pèse cinq points de plus. Ce secteur doit son dynamisme notamment aux activités de sécurité et d’intérim.
tableauFigure 2 – Le commerce contribue le plus à la création de richesse - Principaux résultats des entreprises implantées en Guadeloupe en 2011 (en k-euro)
| Secteur d'activité | Nombre d'unités | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée | Part de la VA dans l'ensemble (%) | Excédent brut d'exploitation |
|---|---|---|---|---|---|
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 2 472 | 1 495 903 | 424 191 | 14,5 | 137 873 |
| - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 538 | 460 206 | 133 066 | 4,5 | 39 726 |
| - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 207 | 148 486 | 37 483 | 1,3 | 13 410 |
| Construction | 4 230 | 1 011 384 | 283 303 | 9,7 | 107 537 |
| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 10 746 | 6 225 675 | 1 076 177 | 36,8 | 246 955 |
| - Commerce : | 7 134 | 5 226 011 | 762 576 | 26,1 | 173 988 |
| dont : | |||||
| Commerce de gros, hors automobiles et motocycles | 1 364 | 2 028 718 | 236 170 | 8,1 | 71 177 |
| Commerce de détail, hors automobiles et motocycles | 4 981 | 2 393 147 | 373 471 | 12,8 | 64 579 |
| - Transports et entreposage | 1 300 | 642 842 | 168 782 | 5,8 | 39 186 |
| - Hébergement et restauration | 2 312 | 356 823 | 144 819 | 5,0 | 33 782 |
| Information et communication | 654 | 350 267 | 161 901 | 5,5 | 111 366 |
| Activités immobilières | 1 101 | 308 986 | 153 417 | 5,2 | 92 750 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 5 089 | 949 428 | 451 875 | 15,4 | 116 263 |
| - Activités de services administratifs et de soutien | 2 805 | 506 808 | 209 278 | 7,2 | 29 207 |
| Enseignement, santé humaine et action sociale | 2 758 | 473 773 | 307 737 | 10,5 | 211 445 |
| - Activités pour la santé humaine | 1 906 | 408 792 | 271 489 | 9,3 | 153 624 |
| Autres activités de services | 1 785 | 133 254 | 66 665 | 2,3 | 22 769 |
| Ensemble | 28 835 | 10 948 669 | 2 925 264 | 100,0 | 1 046 958 |
- Source : Insee – Esane 2011 - Données individuelles
Fortes disparités sectorielles dans les consommations intermédiaires
Les consommations intermédiaires (y compris les achats de marchandises) des différents secteurs du service marchand guadeloupéen représentent 74 % du chiffre d’affaires des entreprises, proportion quasi identique pour les entreprises martiniquaises et guyanaises. Cependant, la part des consommations intermédiaires dans le processus de production crée des disparités sectorielles très fortes. Par exemple, les activités de services, peu consommatrices de produits intermédiaires, affichent des taux de valeur ajoutée (définitions) allant au-delà de 40 %. À l’opposé, le secteur de l’industrie, grand consommateur de consommations intermédiaires affiche un taux de valeur ajoutée de 24 %. Ce qui n’est pas le taux le plus faible de l’ensemble des secteurs. La palme revient au secteur du commerce dont le taux de valeur ajoutée dépasse à peine 12 %. C’est le secteur d’activité où les achats de marchandises pèsent le plus. En effet, ces derniers représentent trois quarts du chiffre d’affaires du secteur (figure 3).
Le taux de marge global enregistré par les entreprises guadeloupéennes s’élève à 35 % en 2011
Le taux de marge (définitions) des entreprises varie selon le secteur d’activité. En effet, les taux de marge des secteurs d’activité tels que les activités immobilières, les activités d’information et de communication font partie des taux les plus élevés, largement au-dessus du taux de marge moyen. À l’opposé, les taux de marge des secteurs de l’industrie et du commerce sont bien en deçà du taux moyen.
Il faut être très prudent sur la comparaison des taux de marge entre secteurs d’activité, car le recours à l’emploi et au capital est spécifique à chaque secteur. De plus, les taux de marge peuvent être sensibles à des effets conjoncturels.
Cela s’explique en partie par le fait, qu’au sein d’un même secteur d’activité, des taux de marge très différents selon les sous-secteurs puissent coexister. Par exemple, le taux de marge du sous-secteur des télécommunications est plus de cinq fois plus élevé que celui du sous secteur de l’édition.
tableauFigure 3 – Les secteurs grands consommateurs de consommation intermédiaire affi chent des taux de Valeur ajoutée bas - Quelques ratios d’analyse fi nancière des entreprises implantées en Guadeloupe par secteur d’activité en 2011 (en %)
| Secteur d'activité | Taux de VA Valeur ajoutée H.T./CA | Taux de marge EBE/VACF | Part des frais de personnel FP/VACF |
|---|---|---|---|
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 28,4 | 32,5 | 67,5 |
| - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac | 28,9 | 29,9 | 70,1 |
| - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 25,2 | 35,8 | 64,2 |
| Construction | 28,0 | 38,0 | 62,0 |
| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 17,3 | 22,9 | 77,1 |
| - Commerce : | 14,6 | 22,8 | 77,2 |
| dont : | |||
| Commerce de gros, hors automobiles et motocycles | 11,6 | 30,1 | 69,9 |
| Commerce de détail, hors automobiles et motocycles | 15,6 | 17,3 | 82,7 |
| - Transports et entreposage | 26,3 | 23,2 | 76,8 |
| - Hébergement et restauration | 40,6 | 23,3 | 76,7 |
| Information et communication | 46,2 | 68,8 | 31,2 |
| Activités immobilières | 49,7 | 60,5 | 39,5 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 47,6 | 25,7 | 74,3 |
| - Activités de services administratifs et de soutien | 41,3 | 14,0 | 86,0 |
| enseignement, santé humaine et action sociale | 65,0 | 68,7 | 31,3 |
| - Activités pour la santé humaine | 66,4 | 56,6 | 43,4 |
| Autres activités de services | 50,0 | 34,2 | 65,8 |
| Ensemble | 26,7 | 35,8 | 64,2 |
- Source : Insee - Esane 2011 - Données individuelles
tableauFigure 4 – L’excédent brut d’exploitation représente près de 70 % de la Valeur ajoutée dans l’enseignement, la santé humaine, l’information et la communication
| Excédent brut d'exploitation | Frais de personnel | |
|---|---|---|
| Ensemble | 35,8 | 64,2 |
| Information et communication | 68,8 | 31,2 |
| Enseignement, santé humaine| et action sociale | 68,7 | 31,3 |
| Activités immobilières | 60,5 | 39,5 |
| Construction | 38,0 | 62,0 |
| Autres activités| de services | 34,2 | 65,8 |
| Industrie manufacturière,| industries extractives et autres | 32,5 | 67,5 |
| Transports et entreposage | 32,0 | 68,0 |
| Activités spécialisées,|scientifiques et techniques... | 25,7 | 74,3 |
| Hébergement et restauration | 24,5 | 75,5 |
| Commerce | 22,8 | 77,2 |
- Source : Insee - Esane 2011 - données individuelles
graphiqueFigure 4 – L’excédent brut d’exploitation représente près de 70 % de la Valeur ajoutée dans l’enseignement, la santé humaine, l’information et la communicationRépartition de la valeur ajoutée des entreprises implantées en Guadeloupe selon le coût des facteurs de production en 2011

- Source : Insee - Esane 2011 - données individuelles
Avertissement
Cette étude utilise des données administratives exhaustives (liasses fiscales). En 2011, une nouvelle méthode d’imputation des liasses fiscales a été introduite rendant délicate la comparaison avec 2010. Pour cette raison, les évolutions entre 2010 et 2011 ne sont pas publiées.
Le champ étudié : le secteur marchand
Le champ étudié dans cet article est celui des entreprises marchandes, y compris auto-entrepreneurs, à l’exception des entreprises du secteur financier (observées par l’Autorité de contrôle prudentiel) et des exploitations agricoles (couvertes par de nombreuses enquêtes gérées par le service statistique du ministère de l’Agriculture).
Les biens et services marchands sont destinés normalement à être vendus sur le marché à un prix calculé pour couvrir leur coût de production.
En toute rigueur, il faudrait parler de services principalement marchands car pour certaines activités coexistent des parties marchandes et non-marchandes ; certains services sont considérés comme toujours marchands (exemple les transports), d’autres comme toujours non marchands (exemple administration générale).
On considère qu’une unité économique rend des services non marchands lorsqu’elle les fournit gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs. Ces activités de services se rencontrent dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’action sociale et de l’administration. Ainsi dans le secteur de « l’enseignement, santé humaine et action sociale » ne sont prises en compte dans cette étude que les entreprises du secteur marchand, hors secteur public : il s’agit donc d’une vision très partielle du poids économique réel de ces activités.
Sources
L’élaboration des statistiques annuelles d’entreprise (Esane) est le système d’information qui permet d’élaborer les statistiques structurelles d’entreprises françaises, à destination à la fois des autorités politiques et administratives françaises (sous l’égide du Cnis), de la Commission européenne (Eurostat), des statisticiens français et en particulier des comptables nationaux.
Le dispositif Esane combine des données administratives (déclarations annuelles de bénéfices des entreprises et données annuelles de données sociales) et des données obtenues à partir d’un échantillon d’entreprises enquêtées par un questionnaire spécifique pour produire des statistiques structurelles d’entreprises (enquête sectorielle annuelle (ESA)).
Mis en place en 2009 sur l’exercice 2008, ce dispositif remplace le précédent système composé de deux dispositifs avec les enquêtes annuelles d’entreprise (EAE) et le système unifié de statistiques d’entreprises (Suse) s’appuyant sur les déclarations fiscales, en les unifiant.
Le champ d’Esane est celui des entreprises marchandes à l’exception du secteur financier et des exploitations agricoles. Ce champ est défini à partir des codes de la nomenclature d’activité NAF.
Les soldes comptables présentés dans cette étude sont calculés à partir d’Esane.
Définitions
Le taux de valeur ajoutée :
Le taux de valeur ajoutée mesure la performance de l’outil de production, le degré d’intégration ou de sous-traitance d’une entreprise dans une filière de production. Plus ce taux est élevé, plus l’entreprise contribue à créer de la valeur et plus elle est intégrée dans le tissu économique. Une entreprise qui réalise en interne l’ensemble de la chaîne de production aura un taux de valeur ajoutée plus important que celle qui sous-traite certaines étapes, à chiffre d’affaires égal.
Taux faible : peu de main d’œuvre, processus court, activité commerciale.
Taux élevé : part importante de la main d’œuvre dans les processus, activité de services.
Le taux de marge :
La valeur ajoutée au coût des facteurs de production (y compris les subventions d’exploitation, hors impôts et taxes d’exploitation) permet aux entreprises de payer les frais de personnel et de dégager un excédent brut d’exploitation... Le taux de marge est le rapport de l’EBE sur la valeur ajoutée aux coûts des facteurs de production (VACF). La comparaison des taux de marge entre secteurs est un exercice délicat. Chaque secteur présente en effet des particularités vis-à-vis du recours à l’emploi et au capital et du cycle conjoncturel. Les secteurs capitalistiques ont de fait un taux de marge plus élevé que les secteurs de main-d’oeuvre. Dans le partage de la VACF, le taux de marge rend compte de ce qui reste à disposition des entreprises, l’EBE notamment, pour rémunérer le capital, une fois déduites les rémunérations salariales. Un taux de marge élevé résulte en général de la mise en oeuvre d’un capital d’exploitation important ; il n’implique pas nécessairement une rentabilité économique forte (l’EBE devant alors être rapporté à ce capital d’exploitation) mais sert à financer les investissements. La taille des entreprises, mesurée par l’effectif salarié, influe sur les taux de marge. Le taux de marge est plus élevé en règle générale dans les entreprises de moins de dix salariés que dans les autres. Les microentreprises intègrent des travailleurs individuels indépendants (commerçants, artisans, professions libérales), et des gérants majoritaires de SARL, qui ne sont pas salariés mais rémunèrent leur travail sur le résultat de l’entreprise. Le taux de marge s’en trouve augmenté mécaniquement. Or, les microentreprises sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses aux Antilles-Guyane qu’en France. La comparaison des taux de marge n’est donc juste qu’à structure équivalente.
Comprendre les soldes comptables :
Le chiffre d’affaires se compose de la production vendue de biens et services et les ventes de marchandises. Les marchandises ne sont pas une production réalisée par l’entreprise qui les commercialise, contrairement aux productions vendues de biens ou services. Contrairement au chiffre d’affaires, la valeur ajoutée hors taxes correspond à ce qui est vraiment créé par l’entreprise. Elle s’obtient en additionnant le chiffre d’affaires, la production stockée et les autres produits d’exploitation, auxquels sont retranchées les consommations intermédiaires, les charges d’exploitation et la variation de stock. Les valeurs ajoutées peuvent s’additionner car les consommations intermédiaires sont soustraites. Transformées, ces consommations permettent la production d’autres biens ou services ou la vente de marchandises. Certains secteurs d’activités bénéficient de subventions. Les entreprises sont également taxées. La valeur ajoutée au coût des facteurs de production s’obtient en ajoutant à la valeur ajoutée les subventions et en retranchant les impôts et taxes. La valeur ajoutée au coût des facteurs de production se divise en deux parties :
- les frais de personnel qui permettent la rémunération du facteur de production « travail » ;
-l’excédent brut d’exploitation qui s’interprète comme le revenu du facteur de production « capital »
L’excédent brut d’exploitation (EBE) n’est pas seulement la rémunération des apporteurs de capitaux ou le bénéfice de l’entreprise. Il permet de rémunérer les actionnaires, mais également de rembourser les dettes ou de financer des investissements. Il rémunère également le travail des entrepreneurs individuels.
Pour en savoir plus
Brion P., « Esane, le dispositif rénové de production des statistiques structurelles d’entreprises », Courrier des statistiques n° 130, mai 2011.
Picard C., « Rentabilités d’exploitation sectorielles - La construction et l’industrie pharmaceutique en tête en 2001 », Insee Première n° 989, octobre 2004.
Benhaddouche A., « En 2011, le secteur marchand martiniquais génère 40 % de la richesse produite sur le territoire », Insee Analyse Martinique n° 12, Octobre 2016.
Benhaddouche A., « En 2011, le secteur marchand guyanais génère un tiers des richesses produites sur le territoire », Insee Analyse Guyane n° 16, Octobre 2016.



