 Insee Première ·
Mai 2022 · n° 1903
Insee Première ·
Mai 2022 · n° 1903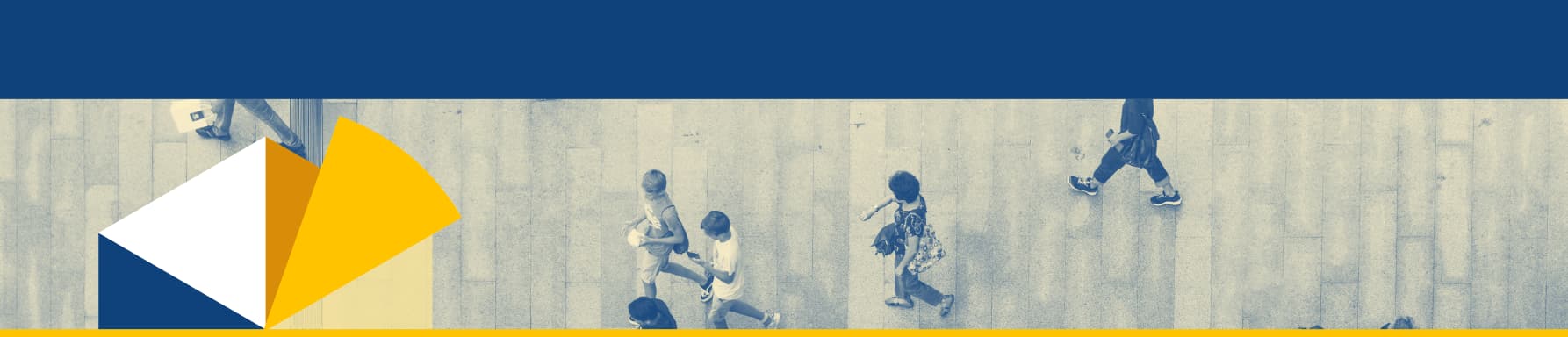 Le compte des administrations publiques en 2021 Vif rebond des recettes, nouvelle hausse soutenue des dépenses
Le compte des administrations publiques en 2021 Vif rebond des recettes, nouvelle hausse soutenue des dépenses
En 2021, le déficit public s’établit à 160,7 milliards d’euros, après 205,5 milliards d’euros en 2020, soit 6,4 % du produit intérieur brut après 8,9 %. Les dépenses liées à la crise sanitaire se maintiennent, tandis que celles qui avaient ralenti du fait des arrêts d’activité en 2020 rebondissent. De plus, les dépenses des administrations publiques sont stimulées par la montée en charge du plan « France relance ». En contrepartie, les recettes publiques augmentent fortement du fait du rebond de l’activité et du financement d’une partie du plan de relance par l’Union européenne. Comme en 2020, le déficit des administrations publiques est porté par les administrations centrales et les administrations de sécurité sociale. La dette publique s’élève à 112,5 % du PIB fin 2021, après 114,6 % fin 2020.
- En 2021, le déficit public atteint 6,4 % du produit intérieur brut
- Le taux de prélèvements obligatoires est quasi stable, à 44,3 % du PIB en 2021
- Les dépenses progressent de nouveau fortement en 2021
- Le déficit des administrations centrales s’établit à 143,4 milliards d’euros en 2021
- Le déficit des administrations locales se réduit, les collectivités locales sont excédentaires
- Le solde des administrations de sécurité sociale se redresse nettement
- La dette au sens de Maastricht s’établit à 112,5 % du PIB fin 2021
- Encadré – Le plan « France relance » et les dépenses de soutien d’urgence face à la crise sanitaire
En 2021, le déficit public atteint 6,4 % du produit intérieur brut
En 2021, le déficit public au sens de Maastricht atteint 160,7 milliards d’euros (Md€), soit 6,4 % du produit intérieur brut (PIB), en baisse de 44,9 Md€ par rapport à 2020 (figure 1, figure 2 et figure 3). Malgré la reprise économique, le solde public est toujours affecté par la crise sanitaire. Les recettes publiques augmentent fortement du fait du rebond de l’activité et des financements par l’Union européenne du plan de relance. Ce dernier contribue à maintenir une progression dynamique des dépenses (encadré). L’État, en supportant la majeure partie du coût des mesures de soutien d’urgence et de relance, contribue au besoin de financement à hauteur de 143,7 Md€. Le déficit des administrations de sécurité sociale (ASSO) s’établit à 16,7 Md€. Les administrations publiques locales (APUL) sont proches de l’équilibre (déficit de 0,6 Md€) : les collectivités locales affichent un excédent de 4,7 Md€ tandis que le déficit des organismes divers d’administration locale augmente. Les organismes divers d’administration centrale (ODAC) sont également proches de l’équilibre.
tableauFigure 1 – Principaux ratios de finances publiques
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Déficit public1 | – 2,3 | – 3,1 | – 8,9 | – 6,4 |
| Dette publique (brute)1 | 97,8 | 97,4 | 114,6 | 112,5 |
| Dette publique nette2 | 89,2 | 88,9 | 102,2 | 100,9 |
| Recettes publiques | 53,4 | 52,3 | 52,5 | 52,6 |
| Dépenses publiques | 55,6 | 55,4 | 61,4 | 59,0 |
| Prélèvements obligatoires3 | 44,7 | 43,8 | 44,4 | 44,3 |
- 1. Au sens du traité de Maastricht ; voir définitions.
- 2. La dette publique nette est égale à la dette publique brute diminuée de certains éléments d'actif ; voir définitions.
- 3. Le taux de prélèvements obligatoires est calculé hors crédits d'impôt.
- Lecture : en 2021, le déficit des administrations publiques représente 6,4 % du PIB.
- Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.
tableauFigure 2 – Dépenses et recettes publiques entre 1993 et 2021
| Déficit public | Dépenses publiques | Recettes publiques | |
|---|---|---|---|
| 1993 | – 6,4 | 55,2 | 48,8 |
| 1994 | – 5,4 | 54,6 | 49,2 |
| 1995 | – 5,1 | 54,8 | 49,7 |
| 1996 | – 3,9 | 54,9 | 51,0 |
| 1997 | – 3,7 | 54,5 | 50,9 |
| 1998 | – 2,4 | 52,9 | 50,5 |
| 1999 | – 1,6 | 52,6 | 51,0 |
| 2000 | – 1,3 | 51,7 | 50,3 |
| 2001 | – 1,4 | 51,7 | 50,3 |
| 2002 | – 3,2 | 52,8 | 49,6 |
| 2003 | – 4,0 | 53,3 | 49,3 |
| 2004 | – 3,6 | 53,0 | 49,4 |
| 2005 | – 3,4 | 53,3 | 49,9 |
| 2006 | – 2,4 | 52,9 | 50,4 |
| 2007 | – 2,6 | 52,6 | 49,9 |
| 2008 | – 3,3 | 53,3 | 50,0 |
| 2009 | – 7,2 | 57,2 | 50,0 |
| 2010 | – 6,9 | 56,9 | 50,0 |
| 2011 | – 5,2 | 56,3 | 51,1 |
| 2012 | – 5,0 | 57,1 | 52,1 |
| 2013 | – 4,1 | 57,2 | 53,1 |
| 2014 | – 3,9 | 57,2 | 53,3 |
| 2015 | – 3,6 | 56,8 | 53,2 |
| 2016 | – 3,6 | 56,7 | 53,0 |
| 2017 | – 3,0 | 56,5 | 53,5 |
| 2018 | – 2,3 | 55,6 | 53,4 |
| 2019 | – 3,1 | 55,4 | 52,3 |
| 2020 | – 8,9 | 61,4 | 52,5 |
| 2021 | – 6,4 | 59,0 | 52,6 |
- Lecture : en 2021, les dépenses des administrations publiques s'établissent à 59,0 % du PIB.
- Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.
graphiqueFigure 2 – Dépenses et recettes publiques entre 1993 et 2021

- Lecture : en 2021, les dépenses des administrations publiques s'établissent à 59,0 % du PIB.
- Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.
tableauFigure 3 – Capacité (+) ou besoin (–) de financement des administrations publiques
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| État | – 66,0 | – 85,7 | – 180,2 | – 143,7 |
| Organismes divers d'administration centrale | – 2,6 | – 2,4 | 24,1 | 0,3 |
| Administrations publiques locales | 2,7 | – 1,1 | – 3,5 | – 0,6 |
| Administrations de sécurité sociale | 11,7 | 14,5 | – 46,0 | – 16,7 |
| Ensemble des administrations publiques | – 54,1 | – 74,7 | – 205,5 | – 160,7 |
- Lecture : en 2021, le déficit de l'État est de 143,7 milliards d'euros.
- Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.
Le taux de prélèvements obligatoires est quasi stable, à 44,3 % du PIB en 2021
En 2021, les recettes publiques augmentent de 8,4 % par rapport à 2020. Le taux de prélèvements obligatoires (net des crédits d’impôt) demeure quasi stable à 44,3 % du PIB, après 44,4 % en 2020.
Plusieurs mesures nouvelles ont contribué à abaisser les prélèvements obligatoires à hauteur de 14,8 Md€, en particulier la baisse des impôts de production mise en œuvre dans le cadre du plan de relance, ainsi que la poursuite de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.
Cependant, la croissance spontanée – c’est-à-dire corrigée de l’effet des mesures nouvelles – des prélèvements obligatoires est très vive (+ 9,4 %) si bien que, au total, la croissance des prélèvements obligatoires (+ 8,0 %) est globalement alignée avec celle de l’activité en valeur (+ 8,2 %). Ce dynamisme s’explique notamment par l’évolution spontanée particulièrement allante de la TVA, de l’impôt sur les sociétés (avec un acompte de décembre très dynamique) et, dans une moindre mesure, des droits de mutation à titre onéreux (payés lors des ventes immobilières).
Les dépenses progressent de nouveau fortement en 2021
Les dépenses des administrations publiques augmentent de nouveau fortement, + 4,0 % en 2021 après + 5,1 % en 2020. En particulier, les subventions et autres transferts versés restent très dynamiques (+ 12,5 % en 2021, après + 12,2 % en 2020) sous l’effet du maintien des dépenses liées à la crise sanitaire, du rebond des dépenses qui avaient ralenti du fait des arrêts d’activité en 2020 et de la montée en charge de « France relance ».
Le déficit des administrations centrales s’établit à 143,4 milliards d’euros en 2021
Le besoin de financement des administrations publiques centrales, constituées de l’État et des ODAC, s’élève à 143,4 Md€ en 2021 (figure 4), en baisse de 12,6 Md€ par rapport à 2020. Cette contraction s’explique par une augmentation plus rapide des recettes (+ 8,8 %) que des dépenses (+ 4,3 %) en 2021 : les recettes bénéficient de la reprise et les dépenses sont alimentées notamment par la montée en puissance du plan « France relance ».
tableauFigure 4 – Principales dépenses et recettes des administrations publiques en 2021
| Administrations publiques centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Ensemble des administrations publiques1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En milliards d'euros | Évolution 2021 / 2020 (en %) | En milliards d'euros | Évolution 2021 / 2020 (en %) | En milliards d'euros | Évolution 2021 / 2020 (en %) | En milliards d'euros | Évolution 2021 / 2020 (en %) | |
| Total des dépenses1 | 611,9 | + 4,3 | 280,0 | + 4,1 | 683,1 | + 3,4 | 1 475,6 | + 4,0 |
| Dépenses de fonctionnement2, dont : | 193,4 | + 1,7 | 141,9 | + 4,3 | 114,6 | + 6,4 | 449,9 | + 3,7 |
| consommations intermédiaires2 | 40,9 | + 4,5 | 52,0 | + 6,9 | 32,0 | + 6,5 | 125,0 | + 6,0 |
| rémunérations des salariés | 150,1 | + 1,0 | 86,5 | + 2,8 | 75,7 | + 6,1 | 312,4 | + 2,7 |
| Intérêts versés2 | 31,1 | + 21,6 | 4,0 | – 5,7 | 3,1 | – 8,6 | 38,1 | + 15,0 |
| Prestations sociales en espèces et en nature | 126,0 | – 6,2 | 27,4 | + 0,9 | 518,7 | + 3,2 | 672,1 | + 1,2 |
| Transferts courants entre administrations publiques | 62,3 | + 0,0 | 3,7 | – 15,7 | 20,0 | + 5,9 | 0,0 | /// |
| Autres transferts et subventions | 167,8 | + 18,4 | 48,3 | + 4,0 | 20,0 | – 9,6 | 222,9 | + 12,5 |
| Acquisitions nettes d'actifs non financiers, dont : | 31,2 | – 4,0 | 54,7 | + 7,9 | 6,6 | + 7,4 | 92,6 | + 3,5 |
| formation brute de capital fixe | 30,4 | + 0,3 | 52,7 | + 8,7 | 6,6 | + 7,6 | 89,7 | + 5,6 |
| Total des recettes1 | 468,5 | + 8,8 | 279,4 | + 5,2 | 666,4 | + 8,4 | 1 314,9 | + 8,4 |
| Impôts et cotisations sociales | 391,0 | + 5,2 | 163,5 | + 5,9 | 614,1 | + 8,6 | 1 168,6 | + 7,1 |
| Ventes | 27,0 | + 6,1 | 45,3 | + 9,7 | 22,1 | + 3,9 | 94,4 | + 7,3 |
| Revenus de la propriété | 8,2 | + 45,9 | 3,1 | + 15,4 | 3,7 | + 14,2 | 14,9 | + 30,0 |
| Autres transferts | 42,2 | + 51,0 | 67,6 | + 0,5 | 26,6 | + 6,3 | 37,1 | + 66,7 |
| Capacité (+) / Besoin (–) de financement | – 143,4 | /// | – 0,6 | /// | – 16,7 | /// | – 160,7 | /// |
- /// : absence de résultats due à la nature des choses.
- 1. Dans la colonne « Ensemble des administrations publiques », les transferts entre les trois sous-secteurs (administrations centrales, locales et de sécurité sociale) sont consolidés, si bien que les dépenses et recettes sont inférieures à la somme des dépenses et recettes des trois sous-secteurs.
- 2. Hors correction au titre des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (Sifim) sur les intêrets versés.
- Lecture : en 2021, les dépenses des administrations centrales s'élèvent à 611,9 milliards d'euros et progressent de 4,3 % par rapport à 2020.
- Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.
Le déficit de l’État, à 143,7 Md€, s’améliore de 36,4 Md€ par rapport à 2020. Les ODAC dégagent une capacité de financement de 0,3 Md€, en baisse de 23,8 Md€ par rapport à 2020. Ces évolutions sont affectées par le contrecoup de la reprise de la dette de 25 Md€ de SNCF Réseau par l’État en 2020, opération neutre sur le besoin de financement des administrations centrales, mais qui dégradait le solde de l’État et améliorait le solde des ODAC en 2020 : corrigé de cet effet, le solde des ODAC s’améliore de 1,2 Md€ en 2021, tandis que celui de l’État s’améliore de 11,4 Md€.
Du côté des dépenses, les consommations intermédiaires des administrations centrales progressent de nouveau à un rythme soutenu (+ 4,5 % en 2021, après + 6,3 % en 2020). Les dépenses de personnel progressent presque au même rythme qu’en 2020 (+ 1,0 % en 2021 et + 1,2 % en 2020). Du fait du prolongement du fonds de solidarité et de la montée en puissance du plan « France relance », les subventions versées par les administrations centrales, en particulier l’État et l’ODAC France compétences, sont dynamiques (+ 10,2 Md€ en 2021). A contrario, les prestations sociales versées se replient (− 6,2 % en 2021, contre + 19,8 % en 2020) du fait du moindre recours au dispositif d’activité partielle, financé aux deux tiers par l’État. Cette baisse des prestations est partiellement compensée par la mise en place de l’indemnité « inflation », aide ponctuelle de 100 euros bénéficiant à 38 millions de personnes et intégralement financée par l’État. Malgré des taux d’intérêt qui demeurent historiquement bas, la charge d’intérêt de la dette a nettement augmenté en 2021 (+ 5,5 Md€, soit + 21,6 %) en raison de l’augmentation de l’inflation qui joue fortement à la hausse sur la charge d’intérêt des titres de dette publique indexés. Enfin, la contribution française au budget de l’Union européenne progresse de + 2,8 Md€ en 2021, dont + 1,2 Md€ au titre de la « contribution plastique », nouvelle ressource propre de l’Union européenne mise en place en 2021 afin de contribuer au financement du plan de relance européen.
Du côté des recettes, les impôts courants sur le revenu et le patrimoine rebondissent fortement en 2021 (+ 18,9 Md€, après − 9,3 Md€ en 2020) du fait notamment de l’augmentation marquée des recouvrements bruts de l’impôt sur les sociétés. Les recouvrements de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ont également nettement rebondi après une année 2020 marquée par les restrictions de déplacement. À l’inverse, les recettes d’impôts sur la production et les importations reçues par l’État sont en forte réduction en 2021 (− 15,2 Md€, soit − 9,0 %, après − 15,8 Md€ en 2020), principalement en raison des transferts de recettes de TVA aux administrations publiques locales. En effet, ces transferts viennent en compensation de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et de la réduction des taxes locales sur la production. Les revenus de la propriété et les ventes se rétablissent après la chute enregistrée en 2020. Enfin, les autres recettes progressent fortement (+ 14,3 Md€), du fait du financement européen de « France relance », évalué à 14,4 Md€ en comptabilité nationale en 2021.
Le déficit des administrations locales se réduit, les collectivités locales sont excédentaires
Le déficit des APUL se réduit à 0,6 Md€, après s’être élevé à 3,5 Md€ en 2020. Les collectivités locales dégagent un excédent de 4,7 Md€ (après 0,2 Md€ en 2020), porté par les communes (4,6 Md€, après 3,1 Md€ en 2020) et les départements (excédent de 1,6 Md€, après un déficit de 1,3 Md€ en 2020). Le déficit des régions reste stable, à 1,7 Md€. En revanche, le déficit des organismes divers d’administration locale se creuse, passant de 3,6 Md€ en 2020 à 5,3 Md€ en 2021, en raison principalement de la dégradation du solde d’Île-de-France Mobilités.
Les dépenses locales (+ 4,1 %) progressent moins vite que les recettes (+ 5,2 %), malgré le dynamisme de l’investissement local après la forte baisse de 2020 liée à la crise sanitaire et au renouvellement des équipes municipales (+ 8,7 % après − 9,4 %). Les consommations intermédiaires rebondissent (+ 6,9 %) après leur recul de 2020 (− 3,9 %). Les rémunérations progressent de 2,8 % (après + 1,4 % en 2020), sous l’effet notamment de l’augmentation du nombre d’emplois contractuels et d’insertion, ainsi que de la mise en place de l’indemnité de fin de contrat en janvier 2021. Les prestations sociales progressent faiblement, de 0,9 %, sous l’effet principalement du RSA et de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Les prélèvements obligatoires des administrations publiques locales augmentent de 5,9 %, soit une augmentation moins forte que celle de l’activité en valeur (+ 8,2 %) du fait d’assiettes dépendant faiblement de l’activité économique (impôts fonciers notamment). La baisse des impôts de production est compensée par l’État via un transfert de TVA pour la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et un prélèvement sur recettes pour les mesures sur la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises. Les ventes rebondissent de 9,7 % après leur recul de 7,6 % en 2020, dû aux fermetures d’espaces d’accueil du public lors des confinements.
Le solde des administrations de sécurité sociale se redresse nettement
En 2021, le besoin de financement des ASSO se réduit, à 16,7 Md€, après 46,0 Md€ en 2020. Cette diminution du déficit des administrations de sécurité sociale provient à la fois d’une augmentation franche des recettes (+ 8,4 % après − 3,4 %) et d’un ralentissement des dépenses (+ 3,4 % après + 6,3 %), sous l’effet de la reprise de l’activité économique et de l’extinction progressive de certaines mesures d’urgence.
Les cotisations sociales rebondissent fortement (+ 7,7 % après − 4,4 %) grâce à la conjoncture macroéconomique, en particulier la hausse de la masse salariale privée (+ 8,9 % après − 5,7 %). Les allègements généraux augmentent plus rapidement que la masse salariale en 2021, après une déformation de la masse salariale au détriment des bas revenus en 2020 (sous l’effet de la crise sanitaire et du recours important à l’activité partielle). Les contributions sociales dues par les indépendants et les entreprises au titre de 2021 et susceptibles de n’être pas recouvrées sont estimées à 6,9 Md€, soit un montant plus faible qu’en 2020 (9,7 Md€). La reprise de l’activité économique dynamise aussi les impôts sur le revenu et le patrimoine (+ 5,8 %), ainsi que les taxes et impôts sur la production (+ 12,0 %).
Les dépenses des administrations de sécurité sociale décélèrent (+ 3,4 % après + 6,3 %). Les prestations sociales ralentissent (+ 3,2 % après + 5,3 %) sous l’effet principalement de la baisse de l’activité partielle à la charge de l’Unédic (un tiers des dépenses totales d’activité partielle) et des prestations d’assurance-chômage, ainsi que de la diminution des indemnités journalières maladie. Toutefois, les surcoûts liés à la crise sanitaire restent importants, du fait des tests de dépistage et des dotations aux établissements de santé. Les revalorisations salariales de la fonction publique hospitalière décidées dans le cadre du « Ségur de la santé » soutiennent les rémunérations (+ 6,1 % après + 6,0 %).
La dette au sens de Maastricht s’établit à 112,5 % du PIB fin 2021
La dette publique au sens de Maastricht augmente de 164,9 Md€ en 2021 et s’établit à 2 813,1 Md€ (figure 5). Le ratio de dette publique en point de PIB se réduit à 112,5 %, après 114,6 % fin 2020, principalement en raison du rebond du PIB. La dette publique nette représente 100,9 % du PIB. Elle s’accroît (+ 162,0 Md€) un peu moins que la dette brute, en raison principalement de l’acquisition de titres de créance par les ASSO (+ 2,9 Md€), ainsi que de l’augmentation des trésoreries (+ 2,0 Md€), partiellement atténuées par la diminution des encours de prêts accordés (− 2,1 Md€).
tableauFigure 5 – Dette publique1 et dette publique nette1
| Au 31 décembre 2020 | Au 31 décembre 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dette publique (brute) | Dette publique nette | Dette publique (brute) | Dette publique nette | |
| État | 2 083,8 | 1 895,9 | 2 228,8 | 2 038,4 |
| Organismes divers d'administration centrale | 63,7 | 56,2 | 64,2 | 56,1 |
| Administrations publiques locales | 229,7 | 216,1 | 245,5 | 231,4 |
| Administrations de sécurité sociale | 270,9 | 194,1 | 274,6 | 198,6 |
| Ensemble des administrations publiques | 2 648,1 | 2 362,4 | 2 813,1 | 2 524,4 |
| En % du PIB | 114,6 | 102,2 | 112,5 | 100,9 |
- 1. Voir définitions.
- Lecture : à fin 2021, la dette des administrations publiques est de 2 813,1 milliards d'euros.
- Source : Insee, comptes nationaux, base 2014.
La principale contribution à l’augmentation de la dette au sens de Maastricht est celle de l’État (+ 144,9 Md€), qui s’endette majoritairement en émettant des obligations de long terme (+ 150,3 Md€, après + 123,9 Md€ en 2020). En revanche, l’encours de titres de court terme se replie (− 6,2 Md€, après + 54,7 Md€ en 2020), principalement lors du quatrième trimestre. Par ailleurs, l’État augmente sa trésorerie (+ 4,7 Md€) mais diminue son encours de prêts accordés (− 2,4 Md€), notamment en raison de la conversion du prêt Air France en instrument de capital pour 3,0 Md€.
La contribution des APUL à la dette publique augmente également fortement (+ 15,8 Md€). La Société du Grand Paris (SGP) s’endette de 8,0 Md€, les régions de 3,5 Md€, Île-de-France Mobilités de 2,5 Md€ et les communes de 1,5 Md€. Cet endettement est très supérieur à leur besoin de financement et alimente en partie leur trésorerie sous forme de dépôts au Trésor (+ 14,4 Md€), en particulier celles de la SGP (+ 5,3 Md€) et des communes (+ 4,8 Md€).
La contribution des ASSO à la dette publique augmente plus faiblement (+ 3,8 Md€, après + 77,7 Md€ en 2020). L’accroissement total des titres de dette reste modéré (+ 5,8 Md€), mais un rééquilibrage s’opère entre titres de long terme (+ 32,7 Md€) et de court terme (− 26,9 Md€) après une année 2020 durant laquelle l’endettement de court terme avait été davantage privilégié. En 2021, la Cades poursuit le programme de reprise de dette décidé dans le contexte de la crise sanitaire. Son endettement progresse de 18,4 Md€. Il est compensé par le désendettement de l’Acoss (− 18,4 Md€). Par ailleurs, l’Unédic et les hôpitaux s’endettent (respectivement + 5,4 Md€ et + 1,4 Md€) alors que l’Agirc-Arrco et la Cnaf se désendettent (respectivement − 1,8 Md€ et − 0,8 Md€).
Les ODAC augmentent leur contribution à la dette publique de 0,5 Md€. Cette augmentation est due à l’endettement de France Compétence et de l’ÉPIC BPI, sous forme d’emprunts (respectivement + 1,0 Md€ et + 0,8 Md€). Elle est partiellement compensée par le désendettement de SNCF Réseau (− 1,2 Md€).
Encadré – Le plan « France relance » et les dépenses de soutien d’urgence face à la crise sanitaire
Le déploiement de « France relance », plan de 100 milliards d’euros (Md€) annoncé par le Gouvernement en septembre 2020 et dont la mise en œuvre a débuté la même année, s’est accéléré en 2021. Les principales mesures de ce plan en 2021 sont la baisse des impôts de production, l’aide exceptionnelle à l’apprentissage, l’activité partielle de longue durée ainsi qu’un ensemble d’aides en faveur de l’investissement public. Au total, ces mesures contribuent à augmenter le déficit public de 32,9 Md€ en 2021, après 2,5 Md€ en 2020.
Toutefois, la France a sollicité un financement européen dans le cadre du Plan national pour la reprise et la résilience (PNRR) et l’Union européenne devrait ainsi subventionner à terme « France relance » pour un montant de 39,4 Md€, dont 14,4 Md€ en 2021. Après prise en compte des financements européens, « France relance » contribue à hauteur de 18,5 Md€ au besoin de financement des administrations publiques.
Les mesures de soutien d’urgence adoptées face à la crise sanitaire et économique accroissent le besoin de financement de 61,7 Md€ en 2021 (hors activité partielle de longue durée financée par « France relance »), après 70,7 Md€ en 2020. Les dispositifs principaux ont été prolongés en 2021 pour faire face à la poursuite de la crise sanitaire.
Les allocations d’activité partielle représentent 8,5 Md€ en 2021 (hors activité partielle de longue durée financée par « France relance »), après 25,8 Md€ en 2020.
Les aides versées par le fonds de solidarité s’élèvent à 23,9 Md€ en incluant le dispositif « coûts fixes » et les aides accordées aux secteurs du sport et de la culture, après 16,3 Md€ en 2020 (dont 0,4 Md€ financés par les assureurs). Ces dépenses sont comptabilisées en subventions.
Les exonérations et l’aide au paiement de cotisations sociales s’établissent à 2,9 Md€ en 2021, après 5,8 Md€ en 2020. Comptabilisées comme des subventions et non comme des baisses de prélèvements obligatoires, elles sont financées par l’État, sans effet sur le compte des administrations de sécurité sociale.
Portés par l’Unédic, la prolongation de l’indemnisation des intermittents et des personnes arrivées en fin de droits ainsi que le décalage de l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance-chômage ont dégradé le déficit à hauteur de 5,3 Md€ en 2021, après 2,1 Md€ en 2020.
L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), qui pilote les dépenses de santé, a été rehaussé de 18 Md€ en 2021, après 14 Md€ en 2020, pour financer les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire.
Par ailleurs, certains dispositifs de garantie mis en place en 2020 pour assurer la trésorerie des entreprises et la continuité de l’activité ont été poursuivis, notamment le dispositif de prêts garantis par l’État (PGE), initialement ouvert jusqu’en décembre 2020, puis prolongé jusqu’en 2022. Les prêts accordés contribuent à un excédent de financement de 0,4 Md€ en 2020 et en 2021, les appels en garantie ayant été inférieurs aux rémunérations de garanties.
Thierry Alarcon, Caroline Cann, Guillaume Jarousseau, Sylvia Roose (DGFIP)
Emmanuel Bordellès-Viala, Christophe Delétoille, Kevin Garcia, Guillian Lefevre, Pierre-Nam Lê Vu, Amélie Morzadec, Thomas Ouin-Lagarde, Emmanuelle Picoulet, Victor Prieur, Alban Rochard (DG Trésor)
Définitions
La capacité ou le besoin de financement des administrations publiques est le solde du compte non financier, égal aux recettes diminuées des dépenses. Il correspond au déficit public au sens du traité de Maastricht.
La dette publique au sens de Maastricht est brute, ce qui signifie que les actifs financiers des administrations publiques ne sont pas déduits de leurs passifs. Elle est évaluée en valeur nominale et est consolidée des passifs entre administrations publiques. Elle exclut certains types de passifs, essentiellement les créances commerciales et ceux liés aux délais de paiement.
La dette publique nette est égale à la dette publique brute diminuée des dépôts, des crédits et des titres de créance négociables (évalués à leur valeur nominale) détenus par les administrations publiques sur les autres secteurs institutionnels.
La contribution à la dette d’un sous-secteur est égale à la dette de ce sous-secteur diminuée des passifs détenus par les autres administrations publiques. La somme des contributions à la dette des différents sous-secteurs est égale à la dette au sens de Maastricht de l’ensemble des administrations publiques.
Pour en savoir plus
Amoureux V., Héam J.-C., Laurent T., « Les comptes de la Nation en 2021 », Insee Première n° 1904, mai 2022.
Insee, « Les comptes de la Nation en 2021 », Chiffres détaillés, mai 2022.


