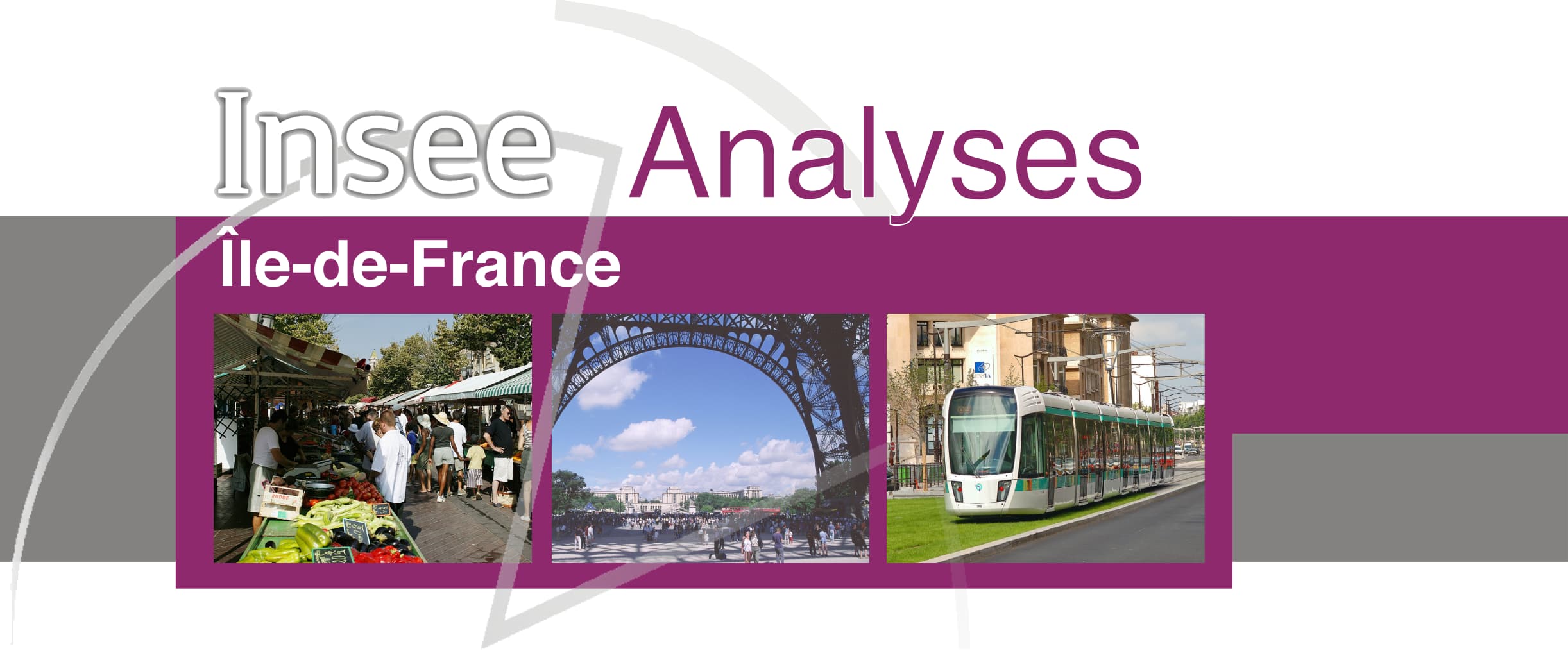 La Seine-et-Marne : un département résidentiel et contrasté
La Seine-et-Marne : un département résidentiel et contrasté
La Seine-et-Marne est le premier département résidentiel de métropole. Sa population a été multipliée par 2,7 depuis les années 60 alors que la progression des emplois a été moins forte. De nombreux résidents travaillent hors du département, en particulier dans la métropole du Grand Paris, et perçoivent plus de la moitié des salaires gagnés par les Seine-et-Marnais. Le profil social du département est typique des classes moyennes. Quatre types de territoires se dégagent : au nord-ouest des pôles d’activités dynamiques, au centre des zones aisées résidentielles, plus à l’est et au sud des zones périphériques plus fragiles. Sur l’ensemble du département, dans les centres urbains anciens ou très récents se concentrent des quartiers en difficulté.
- Le plus vaste département francilien
- Une évolution démographique similaire à celle de la grande couronne
- Un profil social intermédiaire entre Île-de-France et province
- Le premier département résidentiel de France
- Salaires : plus d’un euro sur deux perçu en dehors du département
- Quatre types de territoires
- Les territoires dans la dynamique de la MGP
- Un anneau résidentiel au-delà de la MGP
- Les périphéries fragilisées
- Des poches de pauvreté urbaine
- Des disparités territoriales qui progressent légèrement
Le plus vaste département francilien
La Seine-et-Marne couvre la moitié de la superficie régionale et représente 11,5 % de la population francilienne (1,39 million d’habitants). Seuls 7,8 % des emplois de la région sont présents sur le territoire.
Bien qu’ayant encore plus de 87 % de sa superficie en espaces naturels, forestiers et agricoles, le département connaît à l’ouest un processus d’urbanisation massive qui le rattache de plus en plus à la métropole du Grand Paris (MGP). Pour mieux appréhender ses spécificités, il est comparé à un référentiel composé de quatre départements aux caractéristiques proches et à la grande couronne (Géographie).
Une évolution démographique similaire à celle de la grande couronne
Depuis l’après-guerre, la Seine-et-Marne a connu une croissance rapide de sa population. Celle-ci a été multipliée par 2,7 entre 1962 et 2015, contre seulement 1,7 dans le référentiel de comparaison. Portée par un solde migratoire fortement positif de 1962 à 1990, la croissance démographique, bien que soutenue, ralentit désormais (+ 1,0 % par an). À l’instar des autres départements franciliens, elle est aujourd’hui uniquement imputable à un excédent des naissances sur les décès, le solde migratoire étant proche de l’équilibre.
Les nouveaux arrivants s’installant en Seine-et-Marne viennent à 62 % d’Île-de-France. Un peu plus de la moitié d’entre eux résidaient auparavant dans des départements limitrophes : la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. À l’inverse, 58 % des Seine-et-Marnais qui quittent le département vont s’installer hors Île-de-France, le plus souvent dans un département non limitrophe.
Ainsi, le profil de la population seine-et-marnaise tend à se rapprocher de celui du reste de la région : diminution de la part des ménages avec enfant(s) (51,4 % en 2010, 50,0 % en 2015), augmentation du nombre de familles monoparentales (14 % en 2010, + 1,6 point en 2015). Le département compte toutefois encore davantage d’enfants et moins de personnes de 65 ans ou plus que les départements du référentiel ou ceux de la grande couronne. Cependant, dans les années à venir, le vieillissement de la population serait plus soutenu en Seine-et-Marne que dans le reste de l’Île-de-France. La moyenne d’âge des Seine-et-Marnais, de 37,1 ans en 2015, devrait augmenter de 4,5 ans d’ici 2050.
Un profil social intermédiaire entre Île-de-France et province
La population de la Seine-et-Marne se concentre autour des « classes moyennes ». Alors que les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers représentent les deux tiers des actifs au niveau régional, ils constituent les trois quarts de ceux du département. Si la part de cadres et professions intermédiaires augmente au niveau départemental, elle reste cependant inférieure (44 %) à celle du niveau régional (54 %) mais supérieure à celle du référentiel (38 %).
Cet équilibre social évolue peu par le jeu des migrations résidentielles. Le solde migratoire est neutre pour les cadres et légèrement positif pour les employés et les ouvriers.
En 2015, la moitié des ménages seine-et-marnais percevait au moins 22 340 euros par an et par unité de consommation, le département occupant ainsi une position intermédiaire entre la grande couronne et le référentiel. Le taux de pauvreté (11,8 %) est plus faible que dans le référentiel (12,5 %), la grande couronne (12,7 %) et l'Île-de-France (15,9 %). L’écart de niveau de vie entre les 10 % les plus aisés et les 10 % les plus modestes est inférieur à celui de la grande couronne et équivalent à celui du référentiel.
Le premier département résidentiel de France
Le caractère résidentiel déjà prononcé en 1975 s’est renforcé. Ainsi, avec 73 emplois pour 100 actifs occupés, la Seine-et-Marne détient le ratio d’emplois par actif en emploi le plus faible des départements de métropole (80 % pour le référentiel et 79 % en grande couronne).
Les années 1970 à 1990 ont été marquées par le dynamisme démographique né de l’édification des deux villes nouvelles : Marne-la-Vallée et Sénart. L’autoroute A4 d’un côté, le RER A puis le RER D de l’autre ont accompagné et facilité cette croissance portée davantage par l’habitat que par les activités. Néanmoins, le développement de la plateforme aéroportuaire de Roissy et la création du parc Disneyland ont atténué ce déséquilibre. De 1999 à 2010, la croissance démographique s’est ralentie, alors que se maintenait celle de l’emploi.
Du fait de son caractère résidentiel, comme dans les Yvelines et dans l'Essonne, 43 % des actifs, soit 265 000 Seine-et-Marnais, quittent quotidiennement le département pour aller travailler. Ils se rendent essentiellement à Paris et dans la petite couronne (78 %) qui polarisent fortement ces flux de navetteurs. Seuls 4 % quittent l’Île-de-France. Les cadres sont surreprésentés parmi les sortants (57 %). En sens inverse, environ 100 000 personnes viennent quotidiennement travailler en Seine-et-Marne, essentiellement vers la plateforme de Roissy, le secteur est de Marne-la-Vallée (Val d’Europe) et autour de Melun.
Salaires : plus d’un euro sur deux perçu en dehors du département
Nombreux et plus qualifiés, les Seine-et-Marnais travaillant hors du département perçoivent plus de la moitié des 15,2 milliards d’euros versés en 2015 à l’ensemble des salariés habitant dans le département (figure 1). Ceux qui travaillent à Paris représentent près d’un cinquième de cette masse salariale. À l’inverse, les deux tiers des salaires versés par les établissements situés en Seine-et-Marne sont perçus par des résidents du département, et environ 10 % par des salariés résidant hors Île-de-France, pour lesquels le département fait figure de pôle d’activités économiques.
Quant aux « stables », vivant et travaillant en Seine-et-Marne, leur salaire horaire moyen de 12,90 € est inférieur à celui des résidents travaillant hors du département (16,30 €) et à celui des actifs venant y travailler (15,50 €). En effet, les cadres font des déplacements domicile-travail plus lointains que les ouvriers et les employés.
S’agissant du tissu économique, la sphère présentielle occupe une place prépondérante dans l’économie seine-et-marnaise : plus des deux tiers des salaires versés sur le territoire. Le caractère fortement résidentiel du département en est la raison principale. S’y ajoutent une spécialisation dans l’industrie touristique autour de Disneyland ainsi que la multiplication de grands centres commerciaux, dont certains comme Val d’Europe ou Carré Sénart rayonnent bien au-delà du département.
Le développement économique récent de la Seine-et-Marne a également été axé sur la croissance des activités de logistique et d’entreposage. La logistique imprime une marque particulièrement forte sur le territoire en termes d’espaces artificialisés et de flux routiers, particulièrement vers Sénart et Roissy.
tableauFigure 1 – 8,3 milliards d’euros de salaires perçus hors du département
| Masse salariale créée en Seine-et-Marne (lieu de travail) | Masse salariale détenue en Seine-et-Marne (lieu de résidence) | |
|---|---|---|
| Masse salariale sortante | 3,7 | |
| Dont Hors Île-de-France | 1,2 | |
| En Île-de-France | 2,5 | |
| Masse salariale stable | 6,9 | |
| Masse salariale entrante | 8,3 | |
| Dont Hors Île-de-France | 0,5 | |
| En Île-de-France | 7,8 | |
| Total | 10,6 | 15,2 |
- Source : Insee, DADS 2015.
graphiqueFigure 1 – 8,3 milliards d’euros de salaires perçus hors du département

- Source : Insee, DADS 2015.
Quatre types de territoires
Ces grandes caractéristiques économiques et sociales, notamment le niveau de vie médian et l'origine des revenus, appréhendées à l’échelle du département, masquent de fortes disparités spatiales. Ainsi, au sein de la Seine-et-Marne, quatre types de territoires peuvent être identifiés (figure 2).
tableauFigure 2 – Une bande centrale de territoires plus aisés
| Territoires | Typologie des territoires | Médiane du niveau de vie des EPCI (en euros) |
|---|---|---|
| CA Coulommiers Pays de Brie | Périphéries fragilisées | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CA du Pays de Fontainebleau | Anneau résidentiel | 24 000 ou plus |
| CA du Pays de Meaux | Poches de pauvreté urbaine | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart* | Poches de pauvreté urbaine | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CA Marne et Gondoire | Dans la dynamique de la MGP | 24 000 ou plus |
| CA Melun Val de Seine | Poches de pauvreté urbaine | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CA Paris - Vallée de la Marne | Poches de pauvreté urbaine | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CA Roissy Pays de France* | Dans la dynamique de la MGP | Entre 22 000 et moins de 24 000 |
| CA Val d'Europe Agglomération | Dans la dynamique de la MGP | 24 000 ou plus |
| CC Bassée-Montois | Périphéries fragilisées | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CC Brie des Rivières et Châteaux | Anneau résidentiel | 24 000 ou plus |
| CC Brie Nangissienne | Poches de pauvreté urbaine | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CC des Deux Morin | Périphéries fragilisées | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CC du Pays de l'Ourcq | Poches de pauvreté urbaine | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CC du Provinois | Périphéries fragilisées | Moins de 20 000 |
| CC Gâtinais Val de Loing | Périphéries fragilisées | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CC l'Orée de la Brie* | Dans la dynamique de la MGP | 24 000 ou plus |
| CC Les Portes Briardes entre Villes et Forêts | Anneau résidentiel | 24 000 ou plus |
| CC Moret Seine et Loing | Anneau résidentiel | Entre 22 000 et moins de 24 000 |
| CC du Pays Créçois | Anneau résidentiel | 24 000 ou plus |
| CC du Pays de Montereau | Poches de pauvreté urbaine | Moins de 20 000 |
| CC Pays de Nemours | Périphéries fragilisées | De 20 000 à moins de 22 000 |
| CC Plaines et Monts de France | Dans la dynamique de la MGP | 24 000 ou plus |
| CC Val Briard | Anneau résidentiel | 24 000 ou plus |
- Source : Insee, Filosofi 2015.
graphiqueFigure 2 – Une bande centrale de territoires plus aisés

- Source : Insee, Filosofi 2015.
Les territoires dans la dynamique de la MGP
En premier lieu, les franges nord-ouest du département forment les espaces les plus connectés à la MGP. Comme dans l’ensemble de la partie occidentale du département (de Roissy à Fontainebleau en passant par Marne-la-Vallée), la part des salaires perçus dans les autres départements franciliens y oscille entre la moitié et les deux tiers de la masse salariale versée aux résidents de ces territoires. Le niveau de vie médian des habitants y est élevé ainsi que la part de leurs revenus liés à l’activité. Trois sous-espaces peuvent être identifiés dont deux pôles d’emplois de dimension métropolitaine.
Le premier pôle se situe autour de l’aéroport de Roissy. Le nombre d’emplois rapporté aux résidents en emploi, déjà élevé en 1990, s’est nettement accentué depuis dans la communauté d’agglomération (CA) Roissy Pays de France. À l’inverse, sur cette période, la communauté de communes (CC) voisine de Plaines et Monts de France a renforcé son rôle d’espace résidentiel pour les salariés travaillant dans la zone aéroportuaire.
Un phénomène de polarisation comparable existe entre la CA de Marne et Gondoire, très résidentielle, et celle de Val d’Europe (secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée) concentrant les emplois dans les centres commerciaux et les établissements autour du parc Disneyland (commerces, services, hôtels...). Dans l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de Val d'Europe, le taux de cadres résidents a presque triplé sur les quatre dernières décennies alors qu'il doublait à l'échelon départemental.
Enfin, la communauté de communes de l’Orée de la Brie a développé sa vocation fortement résidentielle en proposant un cadre de vie préservé entre les « villes nouvelles » de Marne-la-Vallée et de Sénart.
Un anneau résidentiel au-delà de la MGP
En deuxième lieu, du Pays Créçois à celui de Fontainebleau, une bande centrale nord/sud s’intègre à un anneau péri-urbain relativement favorisé qui se poursuit vers le nord et l’ouest du département. Il regroupe des populations dont la médiane du niveau de vie dépasse aussi celle du département, mais avec des revenus du patrimoine supérieurs au groupe précédent. Globalement, le taux de cadres (figure 3) y est important et s’accroît davantage qu’ailleurs depuis 1990. Cependant, dans la CA du Pays de Fontainebleau, ce taux déjà très élevé a augmenté à la même vitesse que dans le département.
La qualité du cadre de vie semble être un critère privilégié dans la stratégie résidentielle des habitants qui sont nombreux à travailler dans la MGP, mais moins que le type de territoire précédent, ou dans le pôle d’emplois de Val d’Europe. Au sein de cet anneau, certains secteurs concentrent les hauts revenus du département, notamment ceux de Fontainebleau et du Gâtinais, les abords de la forêt d’Armainvilliers et la basse vallée du Grand Morin. Le territoire de Fontainebleau présente néanmoins de fortes inégalités sociales avec la coexistence de patrimoines très élevés et de revenus très faibles.
tableauFigure 3 – Fort taux de cadres dans le Pays de Fontainebleau et à Val d’EuropeTaux de cadres de 25 à 54 ans (en %) en 1975, en 2015 et effectifs de cadres de 25 à 54 ans en 2015
| Territoires | Taux de cadres | Effectifs de cadres en 2015 | |
|---|---|---|---|
| En 1975 | En 2015 | ||
| CA Coulommiers Pays de Brie | 6,2 | 12,4 | 3 455 |
| CA du Pays de Fontainebleau | 15,3 | 28,2 | 6 688 |
| CA du Pays de Meaux | 8,4 | 13,3 | 4 761 |
| CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart* | 14,7 | 16,6 | 6 838 |
| CA Marne et Gondoire | 9,0 | 24,6 | 10 517 |
| CA Melun Val de Seine | 10,2 | 16,4 | 7 642 |
| CA Paris - Vallée de la Marne | 9,3 | 18,5 | 15 779 |
| CA Roissy Pays de France* | 5,7 | 13,7 | 4 994 |
| CA Val d'Europe Agglomération | 9,8 | 27,2 | 4 316 |
| CC Bassée-Montois | 4,4 | 9,5 | 797 |
| CC Brie des Rivières et Châteaux | 6,1 | 17,6 | 2 734 |
| CC Brie Nangissienne | 4,6 | 11,3 | 1 142 |
| CC des Deux Morin | 3,9 | 10,0 | 948 |
| CC du Pays de l'Ourcq | 4,3 | 9,0 | 597 |
| CC du Provinois | 6,1 | 8,7 | 1 051 |
| CC Gâtinais Val de Loing | 3,8 | 9,7 | 611 |
| CC l'Orée de la Brie* | 7,5 | 17,0 | 1 627 |
| CC Les Portes Briardes entre Villes et Forêts | 13,8 | 22,0 | 3 805 |
| CC Moret Seine et Loing | 8,0 | 18,7 | 2 678 |
| CC du Pays Créçois | 9,1 | 20,7 | 2 992 |
| CC du Pays de Montereau | 4,7 | 7,5 | 992 |
| CC Pays de Nemours | 5,5 | 12,4 | 1 266 |
| CC Plaines et Monts de France | 6,4 | 13,9 | 1 409 |
| CC Val Briard | 7,1 | 16,1 | 1 793 |
| Grande couronne | 12,4 | 22,7 | ** |
| Territoire de référence | 6,9 | 14,2 | ** |
| Seine-et-Marne | 8,7 | 16,9 | ** |
- * EPCI restreints aux communes de Seine-et-Marne.
- ** Effectifs non utilisés car les ordres de grandeurs sont très différents.
- Source : Insee, recensements de la population de 1975 et 2015.
graphiqueFigure 3 – Fort taux de cadres dans le Pays de Fontainebleau et à Val d’EuropeTaux de cadres de 25 à 54 ans (en %) en 1975, en 2015 et effectifs de cadres de 25 à 54 ans en 2015

- * EPCI restreints aux communes de Seine-et-Marne.
- ** Effectifs non utilisés car les ordres de grandeurs sont très différents.
- Source : Insee, recensements de la population de 1975 et 2015.
Les périphéries fragilisées
Une troisième couronne est formée des territoires les plus excentrés du département, à l’est et au sud. Cette ceinture rurale concentre des difficultés sociales et économiques qui la fragilisent. Le niveau de vie médian y est moindre (entre 20 000 et 21 800 € selon les EPCI) que la moyenne départementale (22 340 €) et les habitants sont moins jeunes. En raison du vieillissement de la population, la part des revenus liés aux retraites y est plus forte. L’emploi a baissé depuis quarante ans. La proportion d’employés et d’ouvriers dépasse la moyenne régionale, alors que la part des cadres est réduite. Dans ces territoires, la question de la précarité énergétique est extrêmement prégnante pour plusieurs raisons : distances à parcourir importantes, réseaux de transport en commun peu développés, bâti aux faibles qualités thermiques (pour en savoir plus). Les villes telles que Provins, Nemours, La Ferté-sous-Jouarre et, dans une moindre mesure, Coulommiers y jouent un rôle de pôle de centralité moindre. Au sein de leurs intercommunalités, elles souffrent davantage que les autres de la pauvreté, de la dégradation du bâti et de la dévitalisation de leurs fonctions économique et commerciale. D'ailleurs, pour la plupart, elles bénéficient du programme national d’action Cœur de ville.
Des poches de pauvreté urbaine
Un dernier ensemble de territoires est proche du précédent par la faiblesse du revenu médian des ménages. Mais la démographie y est plus dynamique : la population y augmente de 1,1 % par an contre 0,5 % dans les territoires ruraux. Le poids de l’urbanisation y est davantage marqué puisque les plus grandes villes de Seine-et-Marne (Chelles, Meaux, Melun) s’y trouvent. Enfin, le ratio emploi/actif est moins déficitaire.
Dans quelques communes, en particulier des villes nouvelles de Marne-la-Vallée (secteur II – à l’ouest de la N 104) et de Sénart, les revenus des habitants ont baissé par rapport à la moyenne départementale entre 1984 et 2016. C’est surtout la part des transferts sociaux dans le revenu, comparativement bien plus importante qu’ailleurs, qui distingue ces territoires à l’image du Pays de Montereau (supérieure de 73 % à la moyenne départementale) ou de Meaux (35 %).
Certains quartiers de ces territoires fragiles font l’objet d’une attention particulière dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), comme en témoignent les projets à Savigny-le-Temple, Moissy-Cramayel, Noisiel, Torcy, Champs-sur-Marne, Melun et Meaux.
Des disparités territoriales qui progressent légèrement
Bien que différents et inégalement reliés à la métropole du Grand Paris, les territoires de Seine-et-Marne évoluent en interaction les uns avec les autres. Si certains d’entre eux présentent un nombre important de personnes « stables », travaillant et résidant sur le territoire (le Provinois, Montereau, Melun), plus de la moitié des Seine-et-Marnais travaillant dans le département le font dans une autre intercommunalité que la leur, ce qui représente annuellement 3,8 milliards d’euros de salaires redistribués entre intercommunalités du département.
Au sein de la Seine-et-Marne, les disparités territoriales ont tendance à s’accroître. La part de la population vivant dans des communes aux revenus proches de la moyenne départementale est passée de 80 % en 1984 à 65 % en 2016. Toutefois, cet écart est moindre que dans les autres départements du référentiel ou de la grande couronne, où il peut aller jusqu’à 40 points. À l’exception de Fontainebleau, les territoires centrés sur les villes historiques du sud et de l’est du département (Montereau, Provins, Nangis, Nemours, Melun) ont connu peu d’évolution de revenus, plus faibles qu’ailleurs aujourd’hui comme en 1984. Du côté de Fontainebleau, des bords de Seine ou à l’est de Marne-la-Vallée, dans certaines communes souvent moins peuplées, de nombreuses personnes de catégories sociales favorisées se sont installées.
Parmi les actifs, la part des cadres a doublé en quarante ans en Seine-et-Marne, comme dans la moyenne française, pour atteindre 16 %. Cette part a progressé à un rythme similaire dans quasiment toutes les intercommunalités. Dans les territoires où les « villes nouvelles » se sont développées avant 1990, la progression est moindre. À l'opposé, dans les territoires autour de Val d'Europe, la progression est très forte.
Sources
- Recensements de la population 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2010 et 2015.
- DADS, Filosofi, Clap 2015.
- DGFiP, Ircom 1984, 2016 (communes de plus de 500 foyers fiscaux en 1984).
Définitions
Deux sphères économiques : les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant les besoins de personnes présentes dans la zone (résidents ou touristes). Les activités productives concernent les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes.
Revenu disponible : revenu à la disposition du ménage quel que soit le type de revenu (d’activité…) après prélèvements des impôts directs et des cotisations sociales et versement des prestations sociales.
Niveau de vie : le niveau de vie, le même pour tous les individus d’un ménage, est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Une UC est attribuée au premier adulte du ménage, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans.
Revenu médian : dans la répartition des revenus, 50 % lui sont inférieurs et 50 % lui sont supérieurs.
Masse salariale : la masse salariale est le cumul des rémunérations brutes des salariés (salaires et primes des salariés au cours de l’année d’exercice) hors cotisations patronales.
Géographie
Les quatre départements retenus dans le référentiel sont ceux qui, comme la Seine-et-Marne, ont un territoire à dominante (ou quasi-dominante) périurbaine avec un profil très résidentiel (taux d'emploi sur actifs occupés faible) : l’Ain, l’Oise, l’Eure-et-Loir et l’Eure.
La Seine-et-Marne est aussi comparée à la grande couronne francilienne : les Yvelines, la Seine-et-Marne, l’Essonne et le Val-d’Oise.
La création de cinq villes nouvelles en Île-de-France relevait d’une politique d’aménagement du territoire. Son objectif était la mise en valeur de pôles de développement éloignés du centre de l’agglomération afin qu’ils puissent acquérir une véritable autonomie. Deux villes nouvelles ont été implantées en Seine-et-Marne à partir de 1973 : Marne-la-Vallée et Sénart.
Pour en savoir plus
Indicateurs internet : Dossier complet sur la Seine-et-Marne et site Ouvrir dans un nouvel ongletstatistiques-locales.insee.fr
Gascard N., Lu A. V., « Organisation, fonctionnement et dynamiques de l’espace autour de Paris et de l’Île-de-France », Insee Dossier Île-de-France n° 4, juin 2019.
Allard Th. Bayardin V., Bidoux P-É., Clovis H., Le Carrer M., Lebeaupin F., Monier Ph., Pagès E., « Se chauffer en Île-de-France : la petite taille des logements atténue le coût d’une performance énergétique médiocre », Insee Analyses Île-de-France n° 92, décembre 2018.
Khelladi I., Poncelet T., Trigano L., « La population de la Seine-et-Marne à l’horizon 2050 - Une population en hausse et vieillissante », Insee Flash Île-de-France n° 21, novembre 2017.




