 Services à domicile : quel effet des incitations fiscales ?
Services à domicile : quel effet des incitations fiscales ?
Le souhait des pouvoirs publics de voir se développer les services à domicile a conduit à la mise en place d'un important dispositif d'accompagnement et d'incitations depuis les années 1980. Au sein de ce dispositif, les incitations fiscales auprès des ménages jouent un rôle particulièrement important : elles concernent l'ensemble de ces services et représentent plus de la moitié de la dépense budgétaire consacrée aux services à domicile.
Depuis 1991, les ménages ont la possibilité de déduire de leurs impôts la moitié des dépenses qu'ils consacrent aux services à domicile dans la limite d'un plafond. Ce dispositif ne concernait cependant à l'origine que les foyers fiscaux imposables et les ménages modestes en bénéficiaient donc peu. Depuis 2007, avec la transformation du dispositif en crédit d'impôt, les ménages ne payant pas d'impôt peuvent eux aussi bénéficier d'une mesure fiscale. Cette possibilité concerne les ménages actifs. Elle n'est de ce fait pas ouverte aux ménages âgés qui, parmi les ménages non imposables, sont les principaux consommateurs de services à domicile.
La mise en place de la réduction d'impôt aurait suscité la création de 12 000 à 43 000 emplois en équivalent temps plein et le coût annuel par emploi créé serait compris entre 23 000 et 85 000 euros.
Le nouveau crédit d'impôt génère un coût budgétaire supplémentaire modeste. Ce dernier représente moins de 5 % (*) du coût global du dispositif fiscal. En termes relatifs, l'effet incitatif serait important : la mesure aurait suscité la création de 4 000 à 14 000 emplois pour un coût annuel par emploi compris entre 9 000 et 28 000 euros.
La différence d'impact entre les deux dispositifs s'explique par la nature des populations bénéficiaires. Les ménages concernés par le crédit d'impôt ont spontanément un faible recours aux services à domicile, ce qui limite l'ampleur des effets d'aubaine.
Ce texte s'appuie sur deux études conduites à la division « Redistribution et Politiques Sociales » de l'Insee et au Crest, centre de recherche du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique.
L'évaluation de la réduction d'impôt a été conduite par Claire Marbot et publiée sous forme de document de travail Insee (n° G2011/02).
L'évaluation du crédit d'impôt a été conduite par Claire Marbot et Delphine Roy et publiée dans la même série (n° G2011/12).
(*) Correction du 28 octobre 2011
- Le recours aux services à domicile progresse parallèlement au développement de la législation
- La création de la réduction d'impôt en 1991 aurait été favorable à l'emploi, pour un coût budgétaire relativement élevé
- La réduction d'impôt bénéficie aux ménages aisés, l'introduction du crédit d'impôt en 2007 n'étend que partiellement la mesure
- Mais les emplois créés par le crédit d'impôt l'ont été à moindre coût
Le recours aux services à domicile progresse parallèlement au développement de la législation
La France mène depuis le début des années 1980 une politique volontariste de développement des services à domicile (garde des enfants, aide à domicile pour les personnes âgées, travaux ménagers) destinée à la fois à favoriser l'emploi de travailleurs peu qualifiés et à répondre aux besoins croissants nés d'évolutions sociales telles que le vieillissement de la population ou la hausse de l'activité féminine.
Alors que s'organisait l'intermédiation entre ménages et salariés employés à domicile, et qu'étaient allégées les formalités administratives, les pouvoirs publics ont cherché à solvabiliser une demande latente. La réduction d'impôt introduite en 1991 est au cœur de cette politique de solvabilisation. Contrairement à d'autres dispositifs, généralement ciblés (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant, Allocation Personnalisée d'Autonomie, exonérations de cotisations), elle concerne l'ensemble des services à domicile. Ce dispositif a été complété en 2007 par un crédit d'impôt pour les ménages non imposables. Avec un coût budgétaire estimé à 3 milliards d'euros en 2010, le dispositif fiscal représente plus de la moitié de la dépense publique en faveur du secteur.
Ces évolutions se sont accompagnées d'une forte progression du taux de recours aux services à domicile. La proportion de ménages utilisateurs augmente régulièrement depuis le milieu des années 1990. Les informations les plus fiables et les plus récentes proviennent des données fiscales. Elles ne concernent par définition que le recours déclaré par les ménages aux administrations sociale et fiscale. Selon ces sources, le recours déclaré aurait doublé entre 1996 et 2008, passant de 6,4 % à 12,8 %. Cette évolution soutenue résulte à la fois de la régularisation du travail au noir et de la création d'emplois, du fait d'une meilleure solvabilisation des ménages. Ces deux phénomènes ont en effet été favorisés par le développement des aides, en particulier fiscales, qui bénéficient aux ménages déclarant leurs salariés à domicile.
La création de la réduction d'impôt en 1991 aurait été favorable à l'emploi, pour un coût budgétaire relativement élevé
Lorsque la réduction d'impôt a été instituée en 1991, les ménages imposables ont été incités à dépenser davantage pour les services à domicile tout en les déclarant. En revanche, pour la moitié des ménages qui n'étaient pas imposables, l'incitation à utiliser ces services n'a pas changé. Afin d'estimer l'effet sur l'emploi de l'introduction de la réduction d'impôt de 1991, on se fonde sur la comparaison entre ces deux groupes de ménages. La comparaison porte sur l'évolution de leur taux de recours aux services à domicile entre les années 1989 et 1995, soit respectivement avant et après la création de cette mesure. La comparaison s'appuie sur des données d'enquête qui permettent de mieux approcher l'effet sur le recours réel, qu'il soit déclaré ou pas, plutôt que sur les données fiscales qui ne renseignent que sur le recours déclaré.
La stratégie d'évaluation combine deux éléments (voir « sources et méthodes »). Premièrement, chaque ménage concerné par la mesure est apparié à un « jumeau », similaire du point de vue des caractéristiques sociodémographiques mais non imposable. On compare ensuite l'évolution moyenne entre les paires ainsi constituées (méthode dite de la « différence de différence »). On fait ainsi l'hypothèse qu'en l'absence de réduction d'impôt, l'évolution du recours aux services à domicile aurait été identique pour deux ménages de mêmes caractéristiques observables, si ce n'est que l'un est imposable et l'autre ne l'est pas. Les résultats présentés ici dépendent évidemment de la validité de cette hypothèse, plausible mais impossible à vérifier.
L'application de ces méthodes suppose que les ménages étudiés soient « modérément différents » ; or les ménages imposables sont en moyenne nettement plus aisés que les non imposables. La différence est telle qu'il est nécessaire de se restreindre aux 40 % de ménages de niveau de vie intermédiaire. Cette restriction constitue une limite dans l'évaluation et peut conduire à minorer, dans des proportions difficiles à évaluer, l'effet sur l'emploi. En effet, elle ne permet pas d'en apprécier les effets chez les ménages plus aisés.
Sous cette hypothèse, on peut estimer que 85 000 à 300 000 ménages supplémentaires auraient utilisé ces services (en 1989, 1,8 million de ménages recouraient à des services à domicile). Ceci correspond à une fourchette de 12 000 à 43 000 créations d'emplois en équivalent temps plein (ETP), pour un coût annuel par emploi ETP créé compris entre 23 000 et 85 000 euros.
La réduction d'impôt bénéficie aux ménages aisés, l'introduction du crédit d'impôt en 2007 n'étend que partiellement la mesure
Outre la nécessité d'être imposable pour bénéficier de la réduction d'impôt, un ménage imposable ne pouvait pas obtenir plus que le montant de son impôt sur le revenu. Par conséquent, alors que les trois quarts des ménages utilisateurs de services à domicile avaient bénéficié de la réduction d'impôt en 2006, c'était le cas de moins de 3 % parmi les 30 % d'utilisateurs les plus modestes contre la quasi-totalité des utilisateurs appartenant aux 10 % des ménages les plus aisés.
En 2007, la transformation partielle du dispositif en crédit d'impôt a ouvert le bénéfice du dispositif fiscal aux ménages non imposables : la moitié des sommes dépensées sont remboursées sans que l'impôt sur le revenu ne constitue une limite. Ainsi, par exemple, un ménage qui dépense 2 000 euros dans l'année en services à domicile et paye (avant déduction de cet avantage fiscal) 500 euros d'impôt peut désormais récupérer 1 000 euros contre 500 euros auparavant (figure 1). Cette modification est donc susceptible d'élargir le bénéfice de l'avantage fiscal à des ménages plus modestes. Toutefois, cette possibilité n'est ouverte qu'aux foyers fiscaux dont tous les adultes sont actifs, et donc aux ménages (que l'on appelle ici « ménages actifs ») comprenant un couple marié biactif, une personne active sans conjoint, ou un couple non marié dont au moins l'un des membres est actif, ce qui limite fortement l'élargissement du bénéfice du dispositif. Ainsi, parmi les ménages utilisateurs qui ne bénéficiaient pas de la réduction d'impôt, qui sont essentiellement des personnes âgées, seuls 12 % ont bénéficié du crédit d'impôt en 2007.
En moyenne, 34 % en 2006 et 37 % en 2007 des dépenses d'un utilisateur étaient remboursées par la réduction ou le crédit d'impôt (figure 2). Cette proportion augmente de 0,1 % à 9,9 % entre 2006 et 2007 pour les 10 % les plus modestes ; elle ne change pas pour les 10 % les plus aisés pour qui elle s'élevait déjà avant la mise en œuvre du crédit d'impôt à 49 %, une proportion très proche du maximum (par définition 50 %). Les plus aisés demeurent les plus grands bénéficiaires de l'avantage fiscal car, en plus de bénéficier d'un meilleur taux de remboursement, ils recourent davantage et pour des montants plus élevés : en 2007, ils bénéficiaient de 60 % de l'avantage fiscal total reçu par les ménages utilisateurs, une proportion en légère baisse du fait du crédit d'impôt (la proportion était de 64 % en 2006).
graphiqueFigure 1 – Avantage fiscal pour une dépense de 2 000 euros, selon le montant d'impôt initial
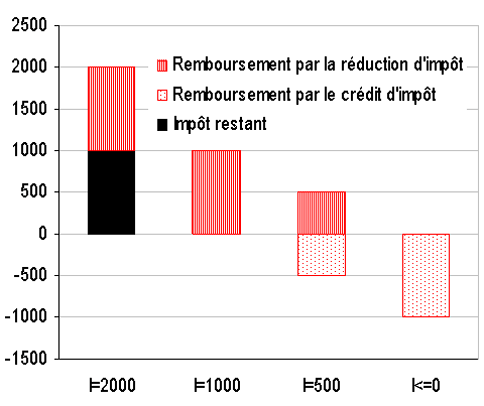
- Lecture : un ménage qui dépense 2 000 euros dans l'année pour des services à domicile et qui paierait un impôt I=500 euros en l'absence de l'avantage fiscal pour l'emploi de salariés à domicile pourrait déduire 500 euros au titre de la réduction d'impôt et (s'il remplit la condition d'activité) 500 euros au titre du crédit d'impôt. Son impôt net, après déduction du crédit d'impôt, serait finalement de -500 euros.
tableauFigure 2 – Taux moyens de remboursement par la réduction ou le crédit d'impôt et part restant à la charge du ménage (en %)
| 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Taux de remboursement ... | |||
| ... par la réduction d'impôt | |||
| Ensemble | 34,0 | 34,8 | 34,9 |
| 1er décile | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 5e décile | 17,7 | 20,4 | 20,0 |
| 10e décile | 49,0 | 48,9 | 48,7 |
| ... par le crédit dimpôt | |||
| Ensemble | - | 1,9 | 2,2 |
| 1er décile | - | 9,7 | 11,6 |
| 5e décile | - | 2,9 | 3,2 |
| 10e décile | - | 0,3 | 0,4 |
| Part restant à la charge du ménage | |||
| Ensemble | 66,0 | 63,3 | 62,9 |
| 1er décile | 99,9 | 90,1 | 88,2 |
| 5e décile | 82,3 | 76,7 | 76,8 |
| 10e décile | 51,0 | 50,8 | 50,9 |
- Lecture : en 2006, en moyenne, 66 % de la dépense d'un ménage utilisateur de services à domicile restait à sa charge, et 99,9 % pour les 10 % de ménages les plus modestes. En 2007, après l'introduction du crédit d'impôt, ces parts restant à charge baissent respectivement à 63,3 % et 90,1 %.
Mais les emplois créés par le crédit d'impôt l'ont été à moindre coût
L'effet du crédit d'impôt sur le taux de recours peut être évalué selon le même type de démarche que celle qui a été retenue pour la réduction d'impôt. La mise en place du crédit d'impôt pour les ménages actifs a modifié l'incitation fiscale de façon variable selon les ménages. Plus précisément, trois types de ménages ont été incités à utiliser des services à domicile ou à accroître leur dépense entre 2006 et 2007 : les ménages qui ne payaient pas d'impôt en 2006, mais aussi ceux qui payaient un impôt positif mais inférieur à la moitié de leur dépense en services à domicile (leur avantage fiscal était alors limité par leur impôt), et enfin les ménages jusqu'ici non utilisateurs de services, mais susceptibles de dépenser en services à domicile plus que le double de l'impôt qu'ils payaient en 2006.
À l'inverse, les ménages qui payaient un impôt sur le revenu suffisamment important n'ont pas été concernés par cette modification de la législation.
Comme pour l'évaluation des effets de la réduction d'impôt de 1991, on effectue une double comparaison à la fois temporelle (entre 2006 et 2007, c'est-à-dire avant et après la transformation en crédit d'impôt) et entre ménages. On distingue alors les ménages pour qui l'incitation à utiliser ces services a changé et ceux pour qui elle demeure la même. En revanche, cette évaluation ne concerne que le recours au travail déclaré car l'estimation s'appuie, cette fois, sur les seules données fiscales : elle peut donc inclure une part de régularisation du travail au noir. On estime qu'entre 35 000 et 108 000 ménages auraient commencé à recourir aux services à domicile du fait de l'introduction du crédit d'impôt.
Les effets obtenus apparaissent relativement importants lorsqu'ils sont rapportés au coût budgétaire du crédit d'impôt (122 millions d'euros en 2007, soit moins de 5 % (*) du coût global de l'avantage fiscal). En effet, les bénéficiaires de cette mesure sont des ménages modestes et plutôt jeunes (du fait de la condition d'activité) et donc peu utilisateurs de services à domicile. De ce fait, l'effet d'aubaine, c'est-à-dire le gain d'un avantage fiscal par des ménages qui recouraient d'ores et déjà aux services à domicile est peu important. Cet effet d'aubaine est en particulier sensiblement moins important que lorsque la réduction d'impôt a été mise en place en 1991. Il est également bien plus faible que celui à l'œuvre lors des hausses de plafond analysées par Carbonnier (2010) ; celles-ci concernent uniquement les gros consommateurs.
Ceci se répercute sur le coût par emploi créé. En supposant que les nouveaux utilisateurs consomment en moyenne autant que les anciens, entre 4 000 et 14 000 emplois auraient été créés par la transformation de la réduction en crédit d'impôt et le coût annuel de chacun de ces emplois serait compris entre 9 000 et 28 000 euros, contre 23 000 à 85 000 euros pour les emplois induits par la seule réduction d'impôt.
(*) Correction du 28 octobre 2011
Sources
Données fiscales et données d'enquête pour deux approches complémentaires du recours aux services à domicile
Les déclarations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) sont une source de données riche d'informations pour évaluer l'effet d'incitations fiscales, puisqu'elles permettent de connaître les montants déclarés par les ménages pour bénéficier de ces avantages fiscaux. Ce sont donc les données fiscales exhaustives de l'IRPP qui sont utilisées pour évaluer la création du crédit d'impôt en 2007.
Cette source présente cependant deux inconvénients. Le premier réside dans le fait qu'elle ne fournit, par définition, pas d'information sur le recours aux services à domicile avant la création de la réduction d'impôt en 1991, et ne permet donc pas d'évaluer directement l'effet de sa mise en œuvre. Pour cela, on utilise donc les données des vagues 1989 et 1995 de l'enquête Budget de famille de l'Insee. Le deuxième inconvénient est lié à la nature fiscale des données qui, par nature, ne contiennent d'information que sur le recours aux services à domicile déclaré à l'administration fiscale. À l'inverse, l'enquête Budget de famille interroge directement les ménages sur leur recours et inclut donc, au moins en partie, le recours non déclaré. Ainsi, l'effet de l'introduction de la réduction d'impôt en 1991 que l'on estime ici à l'aide de données d'enquête est un effet sur le recours total, qu'il soit déclaré ou non. En revanche, l'impact de la création du crédit d'impôt en 2007 mesuré sur données fiscales est un effet sur le recours déclaré, et peut donc inclure une part de régularisation du travail au noir.
L'effet des dispositifs fiscaux est estimé en combinant deux méthodes
Pour évaluer l'effet d'une politique publique sur les individus à qui elle s'applique, il faut savoir comment ces individus se seraient comportés en l'absence de la mesure. Or, ce comportement (le « contrefactuel ») est par définition inobservable. De plus, il existe en règle générale un « biais de sélection » des bénéficiaires, c'est-à-dire que les bénéficiaires ont un profil particulier, ce qui empêche de comparer simplement bénéficiaires et non-bénéficiaires pour en déduire l'effet de la politique. Dans le cas présent, les bénéficiaires de la réduction d'impôt recouraient déjà plus, avant l'entrée en vigueur de la réduction d'impôt, aux services à domicile que le reste de la population : une simple comparaison des taux de recours entre les deux populations conduirait à attribuer à la mesure ce qui relève de caractéristiques intrinsèques des deux populations. Une étape essentielle de l'évaluation consiste donc à identifier un groupe d'individus suffisamment semblable à la population bénéficiaire pour que l'on puisse considérer que ce groupe « de contrôle » se comporte comme se serait comporté le groupe des bénéficiaires en l'absence de la mesure.
Au sein de ce cadre largement utilisé pour l'évaluation des politiques publiques, la méthode retenue ici consiste en une combinaison de deux méthodes classiques d'évaluation :
- L', qui consiste à sélectionner un sous-groupe au sein du groupe des non-bénéficiaires de façon à ce que leurs caractéristiques observables soient proches de celles des bénéficiaires.
- La qui consiste à mesurer le différentiel d'évolution du recours aux services à domicile entre bénéficiaires et non-bénéficiaires.
La combinaison de ces deux méthodes revient donc à supposer que l'évolution du recours aux services à domicile aurait été la même en moyenne entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires qui leur ont été appariés : une fois les caractéristiques observables prises en compte, l'évolution du recours aux services à domicile est supposée indépendante du fait d'appartenir au groupe des bénéficiaires ou au groupe de contrôle apparié.
Plusieurs tests de robustesse
Cette méthode a elle-même fait l'objet de plusieurs variantes. Plusieurs méthodes d'appariement ont été utilisées de manière à s'assurer de la solidité des résultats et de leur cohérence. De plus, s'agissant du crédit d'impôt, deux définitions de la mesure ont été utilisées en parallèle. La première examine la : elle considère qu'il y a création d'une incitation si l'euro supplémentaire par rapport à la dépense de 2006 est subventionné à 50 % par l'avantage fiscal en 2007 alors qu'il ne l'était pas auparavant. Selon la deuxième, c'est le taux de subvention moyen qui détermine l'incitation à recourir davantage ou à commencer à recourir : compte tenu de la dépense du ménage en services à domicile, la part remboursée par l'avantage fiscal a-t-elle augmenté avec la création du crédit d'impôt ? Le recours à ces diverses variantes permet de donner une idée de la marge d'incertitude qui entoure les estimations.
Une autre source d'imprécision est l'effet du blanchiment : si blanchiment il y a, on sous-estime le coût par emploi créé. Cet effet est en principe neutralisé lorsque l'on recourt aux données d'enquête, mais à un degré qui peut se discuter, et il est forcément présent quand on s'appuie sur la source fiscale. En sens inverse, deux facteurs peuvent conduire à surestimer ce coût par emploi créé. En effet, l'évaluation de la création de la réduction d'impôt se limite aux 40 % de ménages de niveau de vie intermédiaire : elle ne prend donc pas en compte les effets qui auraient pu être observés chez les ménages plus aisés. De plus, l'estimation de l'effet des deux réformes ne tient pas compte de l'éventuelle hausse de la dépense des ménages qui recouraient déjà aux services à domicile.
Pour en savoir plus
Cerc (2008), « Les services à la personne », Rapport n° 8 du Conseil de l'Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale.
Flipo A., Fougère D. et Olier L. (2007) « Is the Household Demand for In-home Services sensitive to Tax Reductions? », , 91, 365-385.
Flipo A. et Olier L. (1998), « Faut-il subventionner les services à domicile ? », , n° 316-317, Insee.




