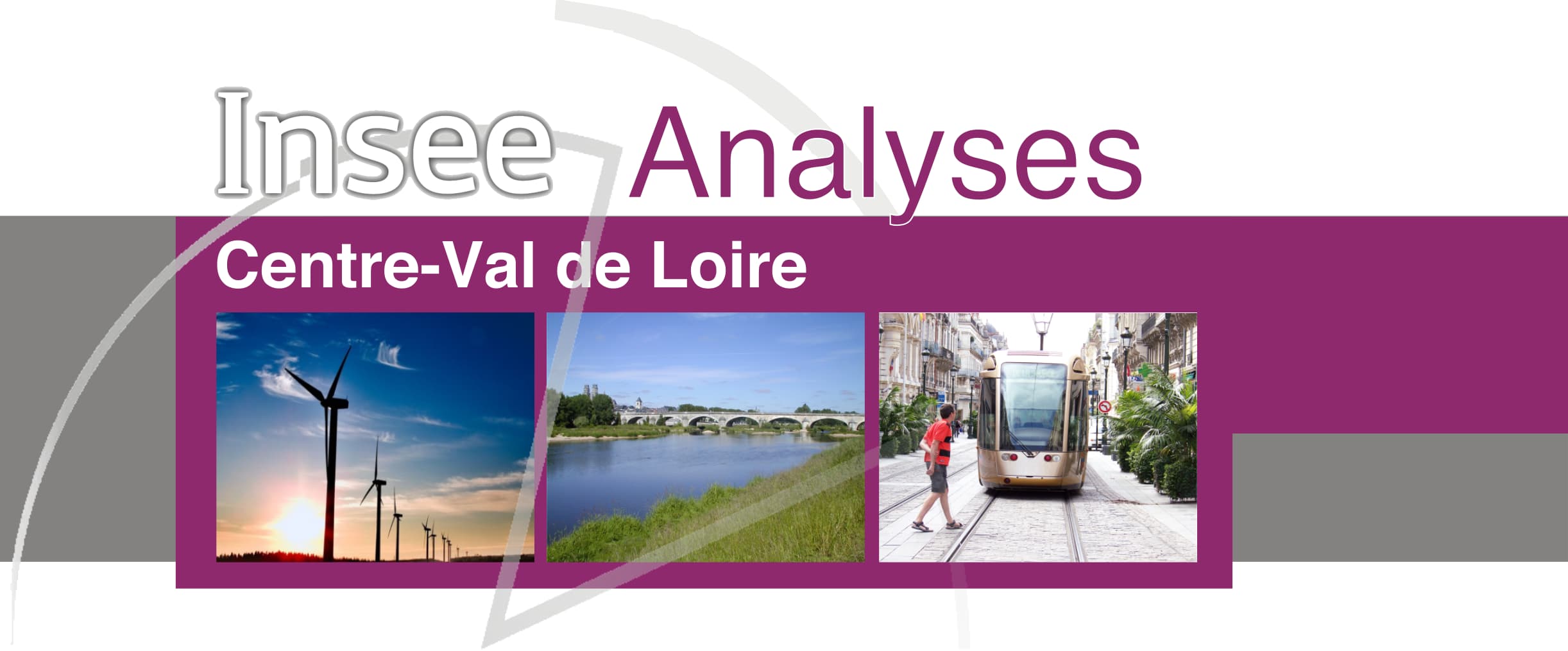 L’intégration des populations immigrées en Centre-Val de Loire : contrastes et difficultés
L’intégration des populations immigrées en Centre-Val de Loire : contrastes et difficultés
La région Centre-Val de Loire n’est pas une terre d'immigration importante, mais elle a pourtant connu un apport significatif de populations étrangères. Récemment, des mouvements migratoires sont venus diversifier les populations accueillies, tant du point de vue des origines que des motifs d’arrivée. Originaires en grande partie du continent africain, les migrants hors Union européenne sont plus présents dans les départements du nord de la région et résident dans les pôles urbains. Ils vivent davantage en couple que la moyenne et occupent des logements sociaux au sein de ménages de taille plus grande. Plus vulnérables face à l’emploi, l’acquisition de la nationalité française et la possession de diplôme limitent leurs difficultés.
- Une population concentrée dans les villes
- Une immigration assez récente et plutôt jeune
- Davantage de non-diplômés mais aussi de diplômés du supérieur
- Des conditions de vie plus fragiles
- Des seniors peu isolés
- Vulnérabilité face à l’emploi, même avec un diplôme
- Encadré partenaire - Un diagnostic pour anticiper les actions à mener
Le programme régional d’intégration des populations immigrées (PRIPI) est l’instrument de mise en cohérence des diverses actions en la matière. Il constitue un outil partagé de suivi et d’orientation de la stratégie locale.
La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) assure le suivi de sa mise en œuvre et son animation, en lien avec les acteurs et partenaires de l’intégration dans la région. Dans ce cadre, elle souhaite disposer d’un diagnostic analysant les conditions de vie et d’accès à l‘emploi des populations concernées par le PRIPI, afin de mieux cibler leurs besoins et de mettre en œuvre les actions préconisées par ce programme visant à favoriser leur insertion dans la société.
En Centre-Val de Loire, près de 100 000 personnes relèvent potentiellement du PRIPI. Il s’agit des immigrés (définitions) à la fois de pays de naissance et de nationalité d’origine hors Union européenne, venus s’installer en France. Cette population est composée à parts égales d’hommes et de femmes. Elle représente 3,9 % de la population régionale (figure 1). Cette proportion, identique à la moyenne de la France de province, place le Centre-Val de Loire au 10e rang des régions.
tableauFigure 1 – Part de la population potentiellement concernée par le PRIPI
| Population étudiée | Part dans la population totale | |||
|---|---|---|---|---|
| nombre | hommes | femmes | ||
| Centre-Val de Loire | 99 330 | 49 791 | 49 539 | 3,9 |
| France de province | 2 005 254 | 1 005 681 | 999 573 | 3,9 |
| France métropolitaine | 3 584 558 | 1 789 082 | 1 795 476 | 5,7 |
- Champ : population immigrée venant des pays tiers à l’Union européenne.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
La population étudiée se caractérise par la présence d’une forte communauté venant d’Afrique : 42 % de ces personnes sont originaires du Maghreb, dont 25 300 Marocains, 13 500 Algériens et 3 500 Tunisiens, et près d’un quart viennent d’Afrique subsaharienne, plus particulièrement du Congo, du Zaïre, du Sénégal et du Cameroun. Par ailleurs, un quart de la population immigrante de la région vient d’Asie, dont la moitié de Turquie.
Les personnes originaires du Maroc, d’Afrique subsaharienne ou de Turquie sont plus représentées en Centre-Val de Loire qu’en moyenne de la France de province (figure 2). À l’opposé, la région accueille proportionnellement peu d’Algériens.
tableauFigure 2 – Une population venant en grande partie du continent africain
| Centre-Val de Loire | France de province | |
|---|---|---|
| Autres| nationalités| d'Europe | 5,8 | 8,5 |
| Algérie | 13,6 | 22,0 |
| Maroc | 25,4 | 22,3 |
| Tunisie | 3,5 | 6,5 |
| Autres| nationalités| d'Afrique | 23,2 | 14,9 |
| Turquie | 11,1 | 8,8 |
| Cambodge,| Laos,| Vietnam | 5,3 | 4,0 |
| Autres| nationalités| d'Asie | 7,8 | 7,8 |
| Amérique,| Océanie | 4,2 | 5,2 |
- Champ : population immigrée venant des pays tiers à l’Union européenne.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
graphiqueFigure 2 – Une population venant en grande partie du continent africain

- Champ : population immigrée venant des pays tiers à l’Union européenne.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
La répartition de ces nationalités diffère d’un département à l’autre. Si la population native du Maghreb, plus particulièrement du Maroc reste fortement présente dans tous les départements, le Loir-et-Cher héberge une part d’immigrés d’origine turque plus importante, tandis que celle venant d’Afrique subsaharienne est plus élevée en Indre-et-Loire et dans le Loiret. Une personne immigrée sur cinq est issue d’Algérie dans le Cher et en Indre-et-Loire. L’Indre se distingue par une proportion d’européens originaires d’un pays hors Union européenne supérieure à celles des autres départements de la région, près d’une personne immigrée sur dix.
Une population concentrée dans les villes
À l’image de la population régionale, les deux tiers de ces immigrés résident sur l’axe ligérien. Du fait de la proximité de l’Île-de-France, les deux départements du nord de la région en accueillent également une grande partie (figure 3). Ainsi, près de quatre sur dix vivent dans le Loiret, qui concentre 25 % de la population de la région. Ils représentent donc 5,8 % de la population départementale, deux points de plus que la moyenne régionale.
tableauFigure 3 – Une présence plus importante dans le nord de la région
| 01 | 6,18890344 |
|---|---|
| 02 | 2,23417242 |
| 03 | 1,9056514 |
| 04 | 3,25348691 |
| 05 | 2,45371379 |
| 06 | 7,10550625 |
| 07 | 2,46874498 |
| 08 | 2,78207057 |
| 09 | 2,66977923 |
| 10 | 4,76131343 |
| 11 | 3,24426961 |
| 12 | 1,76631268 |
| 13 | 7,41864299 |
| 14 | 1,99322741 |
| 15 | 0,90943711 |
| 16 | 1,75534795 |
| 17 | 1,39013908 |
| 18 | 2,58130089 |
| 19 | 2,17340196 |
| 21 | 3,93704117 |
| 22 | 1,13621367 |
| 23 | 1,11739556 |
| 24 | 1,74381696 |
| 25 | 5,61075821 |
| 26 | 4,62693317 |
| 27 | 3,04321633 |
| 28 | 4,15675997 |
| 29 | 1,49196328 |
| 2A | 4,3870041 |
| 2B | 5,47316769 |
| 30 | 5,32544125 |
| 31 | 5,46469284 |
| 32 | 1,58318731 |
| 33 | 3,53326689 |
| 34 | 5,77158213 |
| 35 | 2,55562659 |
| 36 | 1,98226567 |
| 37 | 3,30419264 |
| 38 | 5,36659529 |
| 39 | 3,64947913 |
| 40 | 1,33699208 |
| 41 | 3,37459853 |
| 42 | 5,2809641 |
| 43 | 1,71100944 |
| 44 | 2,71587841 |
| 45 | 5,76652663 |
| 46 | 1,67439944 |
| 47 | 3,50293775 |
| 48 | 1,52261652 |
| 49 | 2,49519259 |
| 50 | 0,80881066 |
| 51 | 3,62675993 |
| 52 | 2,11677587 |
| 53 | 1,58245259 |
| 54 | 4,4135917 |
| 55 | 1,74438021 |
| 56 | 1,41487973 |
| 57 | 4,7158952 |
| 58 | 2,26482429 |
| 59 | 3,95872182 |
| 60 | 4,83178509 |
| 61 | 2,01341052 |
| 62 | 1,31516256 |
| 63 | 3,2038101 |
| 64 | 2,06824772 |
| 65 | 1,87868847 |
| 66 | 3,63550262 |
| 67 | 6,56643642 |
| 68 | 7,13808668 |
| 69 | 8,36629676 |
| 70 | 2,69179582 |
| 71 | 3,17794277 |
| 72 | 2,34819292 |
| 73 | 3,58995009 |
| 74 | 7,22509418 |
| 75 | 14,8880641 |
| 76 | 3,48082287 |
| 77 | 8,12589779 |
| 78 | 8,02487912 |
| 79 | 1,21814368 |
| 80 | 2,19454807 |
| 81 | 2,86799497 |
| 82 | 3,82097364 |
| 83 | 4,01215817 |
| 84 | 6,74261383 |
| 85 | 0,98238311 |
| 86 | 2,68122078 |
| 87 | 3,82763829 |
| 88 | 2,31218489 |
| 89 | 3,65951358 |
| 90 | 6,74109161 |
| 91 | 9,68489893 |
| 92 | 12,6667402 |
| 93 | 23,091618 |
| 94 | 14,215306 |
| 95 | 13,5763582 |
- Champ : population immigrée venant des pays tiers à l’Union européenne.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
graphiqueFigure 3 – Une présence plus importante dans le nord de la région

- Champ : population immigrée venant des pays tiers à l’Union européenne.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
Ces immigrés s’établissent en majorité dans les villes disposant d’un large éventail d’équipements et de services. Plus de sept sur dix résident dans les dix plus grandes unités urbaines du Centre-Val de Loire, où vivent quatre habitants sur dix. Ainsi, plus de la moitié d’entre eux habitent les agglomérations d’Orléans et de Tours, où ils représentent respectivement 8,6 et 5,1 % de la population. Leur part est plus importante à Dreux, où elle atteint 15 %.
En outre, près d’un quart de la population étudiée est concentrée dans quelques quartiers, où elle représente entre 20 et 40 % des habitants, particulièrement à Orléans et à Dreux.
Une immigration assez récente et plutôt jeune
Plus d’un quart de ces immigrés sont arrivés en France au cours des dix dernières années. La structure par nationalité a évolué, l’immigration d’Afrique subsaharienne étant plus importante (figure 4).
Au cours du temps, les profils et les motifs de venue en France ont changé. Après une immigration liée aux besoins de main-d’œuvre durant les « trente glorieuses », les arrivées sont aujourd’hui plus souvent liées au regroupement familial mais aussi aux difficultés économiques et à l‘instabilité politique de certains pays.
La population originaire du continent africain représente toujours les deux tiers de la population immigrante entrant dans le champ de cette étude, bien que la part des nationalités maghrébines soit en repli par rapport aux vagues précédentes.
Parmi les personnes arrivées depuis moins de cinq ans, soit près de 10 800 individus, la moitié a moins de 30 ans. Ce sont plus fréquemment des femmes. Un de ces nouveaux résidents sur sept a déjà acquis la nationalité française. En effet, la durée de résidence de cinq ans, nécessaire avant le dépôt d’une demande, peut être réduite à deux ans après avoir effectué avec succès deux années d'études en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur français. De même, cette acquisition est rendue possible après quatre années de mariage.
Parmi les personnes arrivées sur le sol français depuis plus de cinq ans et en âge d’en faire la demande, une sur deux a acquis la nationalité française.
Ce taux varie fortement en fonction de la nationalité et du pays d’origine : cinq sur dix pour les immigrés issus des pays du Maghreb, quatre sur dix pour ceux du Congo et moins de trois sur dix pour ceux venant de Turquie.
tableauFigure 4 – Une personne sur dix arrivée depuis moins de cinq ans en Centre-Val de Loire
| Moins de 5 ans | 10,9 |
|---|---|
| 5 ans à 9 ans | 15,4 |
| 10 à 19 ans | 16,8 |
| 20 à 29 ans | 13,4 |
| 30 à 39 ans | 15,6 |
| 40 ans et plus | 7,8 |
| Non déclaré |(individu né à l'étranger) | 20,0 |
- Champ : population immigrée venant des pays tiers à l’Union européenne.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
graphiqueFigure 4 – Une personne sur dix arrivée depuis moins de cinq ans en Centre-Val de Loire

- Champ : population immigrée venant des pays tiers à l’Union européenne.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
Davantage de non-diplômés mais aussi de diplômés du supérieur
La scolarisation est un atout permettant une meilleure intégration. De même, un niveau de diplôme élevé est un facteur facilitant. La population entrant dans le champ du PRIPI comprend de nombreux non-diplômés : une personne sur deux n’en a pas ou n’a pas été scolarisée. Cette situation concerne 72 % de la population immigrée turque et 55 % de celle originaire du Maghreb. Ce taux est plus faible parmi la population originaire d’Afrique subsaharienne, avoisinant la moyenne régionale soit 39 %.
Néanmoins, parmi la population cible du PRIPI, plus d’un adulte sur dix a un niveau de diplôme de 2e ou 3e cycle, taux supérieur à celui de la population régionale. De plus, près de 3 % de la population étudiée est inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur. La part des étudiants parmi les 20 à 24 ans dépasse le taux régional de plus de six points.
Ainsi, sur les 1 770 élèves immigrés arrivés dans la région il y a moins de cinq ans, 1 260 poursuivent des études supérieures, soit environ 12 % des primo-arrivants. Ceci est certainement lié aux dispositifs mis en œuvre pour l’accueil dans les universités de la région de jeunes étudiants d’origine étrangère. La proximité de la région parisienne, la facilité de logement et les coûts de location plus faibles en province peuvent également expliquer ce constat.
Des conditions de vie plus fragiles
Des actions visent à favoriser l’accès ou le maintien dans le logement des ménages concernés par le PRIPI. Ils vivent souvent en habitat locatif dépendant d’organismes sociaux (figure 5). Ceci témoigne de leur vulnérabilité économique, d’autant plus qu’ils sont deux fois moins nombreux à accéder à la propriété qu’en moyenne régionale. Les logements sont majoritairement des appartements, conséquence de leur concentration dans les centres urbains. Par rapport à l’ensemble de la population régionale, ils appartiennent plus souvent à des grands ménages et disposent d’un espace par personne plus réduit dans le logement.
La part de ces ménages possédant une voiture diffère peu de la moyenne régionale, rares sont ceux qui en ont plus et un quart n’en a pas. Ce dernier constat est lié à une forte présence dans les centres urbains où l’accès aux transports en commun est facilité.
tableauFigure 5 – Plus souvent locataires
| Ménages étudié | Ménages Centre-Val de Loire | ||
|---|---|---|---|
| nombre | part | ||
| Total | 49 943 | 100,0 | 100,0 |
| Statut occupation | |||
| Propriétaires | 13 499 | 27,0 | 63,6 |
| Locataires | 35 883 | 71,9 | 34,5 |
| dont logement HLM | 26 629 | 74,2 | 44,6 |
| Logé gratuitement | 561 | 1,1 | 1,9 |
| Type de logement | |||
| Maison | 16 957 | 34,0 | 72,1 |
| Appartement | 32 456 | 65,0 | 27,3 |
| Autres | 530 | 1,0 | 0,6 |
- Champ : ménages dont la personne de référence appartient à la population immigrée venant des pays tiers à l’Union européenne.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
Par ailleurs, plus de 3 000 personnes vivent en communauté et représentent 3 % de la population de l‘étude, part plus importante qu’en moyenne régionale. Les deux tiers de ces personnes sont des hommes. Cette population est plutôt jeune ; la moitié est âgée de moins de 30 ans.
Des seniors peu isolés
Parmi la population étudiée, une personne sur dix est âgée de plus de 65 ans. Celles-ci peuvent être concernées par des actions spécifiques. Ces seniors sont plus souvent mariés ou en couple que la population régionale. Ce sont majoritairement des hommes venant du Maghreb. Ils composent des ménages plus grands. Un quart d’entre eux appartient à un ménage de plus de deux personnes, cinq fois plus qu’en région. Ils sont plus souvent actifs que la population régionale de cet âge, respectivement 5 et 2 %.
Vulnérabilité face à l’emploi, même avec un diplôme
Moins de la moitié de la population étudiée âgée de 15 à 64 ans est en emploi, atout facilitant l’insertion. Les immigrés sont plus exposés au risque de la perte de leur emploi car ils occupent des postes dans des secteurs fragiles (industrie, construction). La récession ayant touché ces secteurs, le taux de chômage (définitions) des immigrés est donc particulièrement élevé, notamment pour les jeunes de 25 à 29 ans (29 %). De même, les personnes en recherche d’emploi le sont, en moyenne, depuis plus longtemps qu’en région. Cette vulnérabilité face à l’emploi est également renforcée par un niveau d’études généralement plus faible. En outre, les postes occupés sont plus souvent précaires : intérim, contrats courts et temps partiel. Un emploi sur cinq n’est pas à temps complet. Peu exercent des professions intermédiaires et la part d’hommes ouvriers est plus importante qu’en moyenne régionale. Près de la moitié de la population masculine d’origine asiatique, voire les deux tiers pour celle venant de Turquie, occupent ce type d’emploi.
Les immigrés hors Union européenne de la région exercent dans des secteurs d’activité spécifiques liés fréquemment à la sécurité, à l’entretien de bâtiments, mais également dans le secteur de la santé humaine et de l’action sociale ou dans l’hébergement et la restauration. Près d’un sur dix travaille dans la construction.
Par ailleurs, les femmes sont moins souvent actives, une sur trois n’étant pas sur le marché du travail, contre une sur dix en moyenne régionale. Lorsqu’elles travaillent, elles exercent majoritairement des métiers d’employés faiblement qualifiés, dans les secteurs d’aides aux particuliers et de nettoyage.
Les difficultés liées à l’emploi semblent encore accentuées pour les personnes n’ayant pas acquis la nationalité française (figure 6). Les mesures articulant l’apprentissage de la langue française, avec des actions de formation ou de professionnalisation, présentes dans le PRIPI, visent à limiter les difficultés d’insertion de cette population sur le marché du travail.
tableauFigure 6 – Un accès à l’emploi plus difficile pour les étrangers en Centre-Val de Loire
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population régionale| (1 604 600 personnes) | 64,78830753 | 8,437924161 | 8,729251751 | 10,59689182 | 3,119161479 | 4,328463263 |
| Population étudiée| (84 200 personnes) | 47,40524214 | 20,30272185 | 3,531667861 | 7,523591163 | 12,15727007 | 9,079506923 |
| dont Français| par acquisition| (38 100 personnes) | 57,60638038 | 17,66890167 | 3,888846033 | 5,830999412 | 8,221255243 | 6,783617261 |
| dont étrangers| (46 100 personnes) | 38,97733237 | 22,47871421 | 3,236576731 | 8,921965562 | 15,40910109 | 10,97631005 |
- Champ : population âgée de 15 à 64 ans.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
graphiqueFigure 6 – Un accès à l’emploi plus difficile pour les étrangers en Centre-Val de Loire

- Champ : population âgée de 15 à 64 ans.
- Source : Insee, Recensement de la population 2011.
Comme pour l’ensemble de la population, avoir un niveau de diplôme élevé facilite l’accès à l’emploi. Même si deux immigrés diplômés du supérieur sur trois ont un emploi, seul un sur deux occupe un poste de cadre et un sur quatre exerce une profession intermédiaire. Le fait que les autres aient une activité d’employé ou d’ouvrier témoigne d’un phénomène de déclassement deux fois plus élevé qu’en moyenne régionale.
Le taux de chômage des diplômés du supérieur est plus faible que celui de l’ensemble de la population étudiée. Néanmoins, il reste supérieur de dix points à celui de l’ensemble des actifs diplômés du 2e et 3e cycle de la région.
Encadré partenaire - Un diagnostic pour anticiper les actions à mener
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPLPIS), dont la DRJSCS a en charge la coordination et le suivi de la mise en œuvre, vise à réduire les inégalités et prévenir les ruptures, à venir en aide et accompagner vers l’insertion, à coordonner l’action sociale et à valoriser les acteurs.
Le programme régional d’intégration des populations immigrées (PRIPI) préconise la mise en place d’une politique territorialisée en associant tous les acteurs locaux à partir d’une analyse des situations et des besoins. Il vise à développer des synergies entre acteurs afin de contribuer à intégrer les populations immigrées, réduire les inégalités et favoriser la cohésion sociale.
Dans ce contexte, connaître les conditions de vie, les niveaux de diplômes, les conditions d’accès à l’emploi de ces populations permettra de mieux les cibler et d'identifier les actions à mettre en œuvre.
Le PRIPI, dans sa forme actuelle, est appelé à évoluer pour prendre en compte les récentes orientations prises par le gouvernement visant à un recentrage des moyens et des actions sur les publics étrangers primo-arrivants. Les personnes âgées, et notamment celles accueillies en foyers de travailleurs migrants, seront également visées par les actions à mener.
Dans l’attente d’instructions du ministère de l’Intérieur quant à la nouvelle configuration du schéma d’intégration – régional ou départemental – la présente étude devrait permettre d’éclairer l’action publique à mener dans les prochaines années.
Sources
La population étudiée est celle qui relève potentiellement du PRIPI. En effet, ce programme s’adresse à la population en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne à 27. Ainsi sur les 156 000 immigrés qui résident en Centre-Val de Loire, seuls les deux tiers, soit près de 100 000 personnes, sont concernés.
Définitions
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers.
Le taux de chômage (au sens du recensement) correspond au pourcentage de chômeurs dans la population active.
Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides). Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs notamment).
Les populations étrangère et immigrée ne se confondent donc pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré.
La population active regroupe, parmi les individus âgés de 15 à 64 ans, la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un emploi ») et les chômeurs.
Un chômeur (au sens du recensement) est une personne ayant déclaré au recensement ne pas avoir d'emploi et en rechercher un.
Pour en savoir plus
Acquisition de la nationalité française en hausse parmi les immigrés, Insee Centre Flash n° 60, octobre 2012.
La région Centre, terre de migration, Insee Centre Info n° 156, septembre 2009.
Les immigrés récemment arrivés en France, Insee Première n° 1524,novembre 2014.
Ouvrir dans un nouvel ongletLes immigrés en France, la documentation française, août 2014.
Immigrés et descendants d'immigrés en France, Insee Références - Édition 2012.
Le programme régional des populations immigrées : 56 000 personnes concernées en Bourgogne création, Bourgogne dimensions n° 164, décembre 2010.
Les descendants d'immigrés se sentent au moins autant discriminés que les immigrés, Collection Insee Île-de-France à la page n° 395, octobre 2012.




